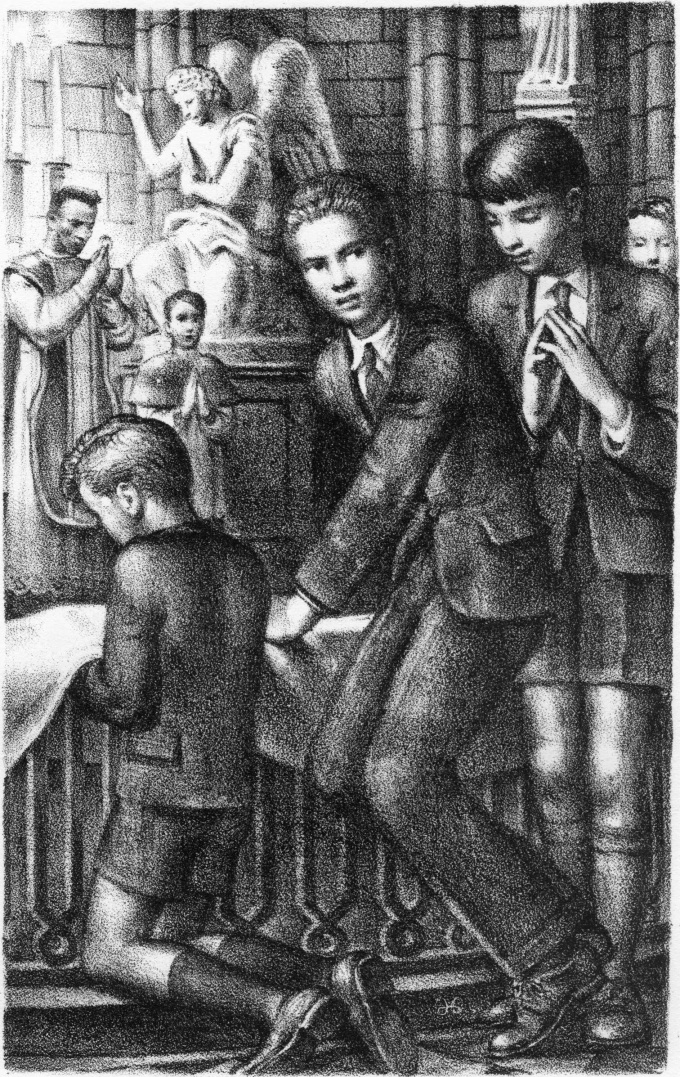Les amitiés particulières (texte intégral) – 2
La deuxième partie du roman de Roger Peyrefitte Les amitiés particulières raconte les vacances de Noël et le deuxième trimestre de Georges de Sarre au collège Saint-Claude, du jeudi 22 décembre au mardi 11 avril.
Georges éprouvait une heureuse surprise à se retrouver chez lui. Il reprenait possession de ce décor qui, de loin, lui était devenu étranger, et il respirait de nouveau le plaisir d’être le fils de la maison. Il n’était plus « Sarcophage » ou « Sardine », surnoms dont on l’affublait quelquefois au collège ; il était Georges de Sarre. Il venait même d’être appelé « Monsieur le comte » par le nouveau domestique. Jamais encore on ne lui avait donné sa qualité. C’est sans doute qu’il avait grandi.
Avant le dîner, il fit le tour du propriétaire. Il avait pris dans ses bras le chat persan, blanc comme une énorme houppe, avec une queue de renard lapon, et qui lui avait cligné de l’œil, daignant le reconnaître. Il songeait à l’enfant qui avait porté l’agneau.
Il fut content de revoir sa chambre. Enfin, une chambre à soi ! Il lui était permis de ne pas regretter le dortoir.
Il fit une gamme à son piano, petit piano de petit roi, où il n’y aurait pas eu assez de place pour jouer avec Lucien.
Le bureau renfermait la chère bibliothèque — la moitié de la première rangée occupée par la Sainte Bible de Ménochius, quinze volumes reliés en maroquin rouge, et, sur cette base solide, encadrée de dictionnaires, les poésies, les romans, les histoires. À côté, la vitrine aux livres anciens, armoriés : c’étaient ceux que l’on n’ouvrait jamais. Georges s’enfonça dans un fauteuil de cuir ; celui-là du moins était confortable, on s’y laissait tomber sans crainte. Au diable les sièges qu’il fallait aborder avec respect, tels que ceux du salon !
Dans cette pièce, Georges fut touché par la douceur de la lumière qui traversait les rideaux. Tout lui parut plein de charme. Les petits personnages de la tapisserie de soie jouaient de la flûte pour l’accueillir. Les portraits l’amusèrent : saint Jean Baptiste enfant levait le doigt, paraissant dire : « C’est moi le plus beau » ; la douairière minaudait avec un singe ; le page avait un air très hors de page. Les collections du médaillier ravivaient à son intention leurs empreintes ternies.
Ses yeux, purifiés par l’austérité de Saint-Claude, découvraient aujourd’hui la magnificence des tapis persans. Il admira la variété de leurs petits dessins, le jeu de leurs couleurs, le serré de leur laine. Sur l’un d’eux, où un bouquet semblait avoir été dispersé, il posa le chat, afin de le regarder se promener à travers les fleurs de son pays.
À la salle à manger, il alluma, par gloire, les deux flambeaux d’argent. Il y avait des pamplemousses dans la corbeille : on n’avait pas oublié ses goûts. C’était dommage que ce fruit ne pût figurer, au collège, dans la caissette aux provisions. Il fallait trop de mise en scène — le sucre en poudre, le kirsch, la glace pilée. Georges croyait avoir oublié toutes ces choses, et il n’était pas fâché de les ravoir.
Il rendit visite à la cuisine, où il apprit qu’en son honneur, il y aurait ce soir un soufflé.
Il fit quelques pas sur la terrasse, puis descendit au jardin et visita la serre.
Dans le garage, sa bicyclette était suspendue à une potence. L’ayant décrochée, il gonfla les pneumatiques, fit sonner le timbre, comme le signal d’un autre bien qu’il recouvrait : la liberté. Il imaginait des randonnées lointaines, où il serait seul, dans le vent. Il regrettait que S… fût, malgré tout, trop loin pour ses moyens ; il aurait aimé y aller ainsi.
Les jours suivants, il rencontra, par-ci par-là, ses anciens camarades du lycée. Ils lui parurent plus dénués d’intérêt que jamais, les uns avec leur folie de cinéma, les autres avec leurs gaudrioles, les sportifs avec leur façon de comprendre le sport. Quant à lui, il n’eut guère l’occasion de montrer comment il comprenait la bicyclette : le mauvais temps de la saison l’en empêchait.
Il écrivit à Lucien une longue lettre. Il lui annonçait que la fameuse Liliane ne viendrait pas : par conséquent, Lucien pourrait venir, sa vertu ne courrait aucun risque. En revanche, Georges ne répondait plus de sa vie : ayant reçu en cadeau de superbes fleurets, et pris des leçons d’escrime, il le défiait déjà à toutes sortes d’assauts, même à pointe démouchetée et fer émoulu. Il lui disait également qu’il avait lu Thaïs et le Cantique des Cantiques, et lui demandait enfin si ses engelures étaient guéries.
Il reçut, bientôt après, cette lettre de Lucien :
Cher Georges,
Je te remercie beaucoup de m’avoir écrit le premier, et de me renouveler ta cordiale invitation. Nos vacances sont malheureusement trop courtes pour que je puisse aller te retrouver. J’ai même juste le temps de répondre : je suis un peu pressé, parce que je fais une série de visites aux crèches des églises (cela rapporte des indulgences). Notre messe de minuit a été très belle : une jeune fille, peut-être aussi belle que ta cousine, a chanté.
Si tu as eu à Noël un attirail d’escrimeur (attention de ne pas t’éborgner toi-même !), j’ai eu, moi, une bicyclette verte. Elle n’est pas de grande marque, comme la vôtre, monsieur, mais elle n’est pas mal : changement de vitesse, porte-bagages nickelé, timbre à deux sons — ding-dong…
Puisque tu me parles de tes lectures, je te dirai ce que je lis : « L’aimable Jésus, traduit de l’espagnol. » C’est très intéressant.
J’y ai trouvé l’image que je t’envoie. Tu y verras une prière « à l’ange gardien d’un enfant absent ». C’est celle que je récite pour toi en ce moment — je la sais par cœur. Récite-la pour moi. Malgré tous mes efforts, j’en ai besoin plus que tu ne penses.
Voici : mon oncle, l’astrologue, prétend qu’il n’aperçoit, dans mon horoscope, aucune indication de ce qu’il appelle du mysticisme. Il assure qu’Uranus et Mars y sont conjoints, ce qui présagerait des choses bien différentes, qu’il se refuse à préciser. Cette idée m’agace, et je ne peux l’avouer qu’à toi, puisqu’elle est ton idée aussi. C’est bête de vouloir croire tout…
Il ajouta en post-scriptum qu’il s’était inscrit dans la « Ligue Maritime et Coloniale », se préparant ainsi à sa carrière de planteur. Les deux amis s’étaient rendus leurs inscriptions.
L’image qu’envoyait Lucien montrait un ange bleu près d’un enfant rose et au dos se lisait cette prière :
Ange gardien de celui que mon cœur vous nomme, veillez avec plus de soin sur lui. Rendez ses pas faciles, ses travaux féconds. Essuyez ses larmes, s’il pleure ; sanctifiez ses joies, s’il en a ; relevez son courage, s’il se sent faible ; ranimez l’espérance, s’il se désole ; la santé, s’il souffre ; la vérité, s’il s’égare ; le repentir, s’il succombe. (Quarante jours d’indulgences.)
Georges restait l’ami de Lucien, mais il lui semblait devenir chaque jour un peu plus l’ami d’un autre, qu’il connaissait à peine, et qui ne le connaissait même pas. Lui aussi, il avait son « enfant absent », qui était à la fois son ange et sa prière. Il pensait souvent au jeune Motier. Comme si c’était se manifester à lui, il voulut se manifester aux gens qui l’entouraient, aux lieux qui le possédaient.
Il avait écrit à Blajan, qui n’avait pas quitté S…, pour lui demander les adresses exactes de Maurice et du père Lauzon. Il aimait à se rappeler que le nom de cette ville avait figuré dans leur première conversation au collège.
Marc, en le renseignant, se montra sensible à son souvenir : une lettre personnelle était autre chose que la lettre collective de la classe, où il n’y avait que deux lignes contresignées par tout le monde. Marc était destiné à être la dupe des intentions de Georges : de même, naguère, il avait cru dicter le choix du père Lauzon en qualité de confesseur, et ce choix n’avait été dicté que par Lucien.
Georges s’empressa d’envoyer ses vœux de nouvel an au père et à Maurice. Il traça, pour la première fois, le nom de Motier. Sans doute, Maurice serait-il surpris de recevoir cette missive, car il n’était pas très lié avec l’expéditeur ; le père également, puisque la rentrée était si proche. Et Georges regrettait qu’en raison de la date tardive, Maurice au moins n’eût pas le loisir de lui répondre. Cette lettre l’aurait intéressé. Peut-être que l’enfant l’aurait lue, comme il lirait peut-être celle que Georges avait écrite.
Le jour de l’an, celui-ci aperçut, dans la vitrine d’une papeterie, une exposition d’images de piété. Il s’arrêta, songeant qu’il y aurait là de quoi rendre à Lucien son cadeau. Ce n’était pas si aisé. Lucien était abondamment pourvu : il avait tous les anges et tous les saints dans ses livres et dans sa boîte. Ceux que l’on voyait ici, sous un aspect plus ou moins différent, étaient les mêmes qu’il avait déjà. Il aurait fallu quelque chose d’original : un ange rare, comme ceux que citent les poètes parnassiens, un bienheureux de fraîche date, ou un de ces saints inconnus qui ne sont jamais sortis du martyrologe.
Des photographies de musée, repoussées par les images édifiantes, garnissaient un coin de la vitrine. Une d’elles, qui représentait le buste d’un jeune dieu, fixa l’attention de Georges : la tête charmante, au regard profond, s’inclinait légèrement sur une épaule, et de longues boucles de cheveux tombaient sur l’autre. Il entra et l’acheta. Elle portait au verso cette légende : « L’amour de Thespies. Musée du Vatican. » Le rapprochement de ces termes parut à Georges symbolique : une radieuse amitié l’attendait à Saint-Claude, comme cet Amour qui s’élevait, apologie du paganisme, près de la demeure même du vicaire du Christ. Il décida de conserver la gravure pour lui, et la mit dans son portefeuille : elle serait la sauvegarde de l’année qui commençait. Il y joindrait, en souvenir, celle de l’ange gardien.
Mardi, 3 janvier : la rentrée. À cause de la neige, il n’aurait pas été agréable d’aller au collège en voiture, et Georges prit le train. Aujourd’hui, c’était lui qui partait et ses parents qui restaient.
Lucien, venant de plus loin, lui avait gardé une place. Son visage rayonnait. Il était impatient d’emmener Georges dans le couloir afin de lui apprendre la nouvelle : André avait écrit, sa lettre était arrivée hier.
« C’est inouï, dit-il : juste le dernier jour ! En un instant, j’ai été transformé. Ma « déconversion » a été aussi rapide que ma conversion. C’était drôle : à mesure que je lisais, je croyais sentir médailles et scapulaires tomber le long de mes jambes. Les indulgences, les chapelets, l’ange gardien, « L’aimable Jésus », tout ça est liquidé. Mon oncle et toi, vous aviez raison.
— Gare ! ce sera mon tour de te convertir.
— Je ne crois pas que nous ayons un grand crédit, ni l’un ni l’autre, en fait de conversions. »
Lucien ne résista pas davantage au plaisir de montrer à Georges la fameuse épître qu’il lui avait apportée.
« Tu n’as pas connu les vers d’André, dit-il, mais tu vas avoir une idée de sa prose. »
Mon cher Lucien,
Je pense que tu seras heureux de recevoir enfin de mes nouvelles, avec mes vœux de bonne année. Tu m’aurais déjà lu, si je n’étais arrivé en vacances fortement grippé. Je ne voulais pas t’écrire avant d’être guéri. Notre amitié ne doit connaître que le beau et l’aimable. Je dis : « notre amitié », parce que je suis certain que l’absurde séparation n’y a rien changé. D’ailleurs, que peut-on changer aux astres, qui nous lient pour toujours ?
Laisse-moi te gronder d’abord de m’avoir fait mettre à la porte, ensuite de ne pas m’avoir écrit. Je te reproche beaucoup plus ton silence que ton étourderie, parce que tu n’as pas fait exprès, évidemment, d’égarer la poésie qui a causé mes malheurs.
Te souviens-tu de ces vers, que j’avais copiés pour toi — et tant soit peu revisés — dans cet auteur malfamé, du début de ce siècle, qui se nomme Fersen ? Peut-être n’as-tu pas même su, en effet, qu’ils avaient compté si terriblement pour moi. J’avais eu l’imprudence de mettre mon nom au bas de ces strophes, mais le tien, par bonheur, ne figurait pas dans la dédicace, et c’est ce qui t’a sauvé.
Tu aurais ri de ma discussion avec le supérieur au sujet du baron de Fersen, dont, malgré mes affirmations, il me niait l’existence, tenant à me faire avouer que le poème était de moi. Pour me confondre, il a même regardé dans ses dictionnaires, où, malheureusement, il y avait tous les Fersens de la création, sauf celui-là.
Du reste, auteur ou copiste, j’étais cuit. Je n’avais plus qu’à jouer la petite scène classique du repentir, avec passage gradué de l’attrition à la contrition, les larmes de la componction brochant sur le tout.
J’avais intérêt à ne pas être trop noirci aux yeux de mes parents et, comme on dit, à enterrer la synagogue avec honneur. C’est ainsi que j’ai été admis, sans difficulté, au lycée de… comme interne. Voilà ce qu’il en coûte d’aimer quelqu’un chez les bons pères. Je crois qu’ils sont jaloux, c’est l’éternelle histoire du « renard ayant la queue coupée ».
Je rêve souvent à nos prochaines grandes vacances. J’espère bien, n’est-ce pas ? que ta famille ira de nouveau à …, comme la mienne. J’évoque souvent aussi l’été dernier, le merveilleux été qui me réchauffe encore loin de toi. Il me semble revivre cette nuit en montagne, où nous avons dormi avec la lune, comme deux Endymions. À vrai dire, c’est toi qui dormais et je te regardais dormir. Le tableau était de nature à inspirer M. de Fersen.
Mais plutôt que d’en faire des poèmes, gardons tous ces souvenirs au plus profond de nous. Là, personne ne peut s’en emparer. Là, personne ne peut empêcher André de rester près de Lucien, et de l’embrasser comme autrefois…
Cette lecture avait charmé Georges. Il avait été satisfait de constater qu’André ne l’impliquait nullement dans l’affaire du poème. Le supérieur n’avait pas dit où ces vers avaient été trouvés. La piste était brouillée ; c’était beaucoup mieux. D’ailleurs, Lucien n’aurait pas eu tellement à se plaindre de Georges, puisque André l’aimait toujours. Et Georges n’avait plus à être jaloux, puisque à son tour, il aimait quelqu’un. C’est principalement à cause de cela que cette lettre lui avait été si agréable ; elle parlait le langage de la tendresse qu’il sentait en lui. Elle correspondait à son propre état.
On venait de quitter la gare de S…, où l’enfant avait dû monter dans le train. Georges avait été tenté de regarder, mais ne bougea pas de son coin. Il était sûr de cette présence par le trouble extraordinaire qui l’avait saisi. À peine écoutait-il les remarques de Lucien, touchant la poésie que celui-ci ne se souvenait pas d’avoir gardée ni perdue, et ses intentions de se débarrasser du service des œuvres pies sur tel ou tel camarade.
Peu à peu, les douces impressions où était Georges firent place à d’autres. Il était effrayé de se découvrir une telle passion ; celle d’André et de Lucien lui semblait, en comparaison, peu de chose. Il n’était plus intimidé par l’enfant, mais par lui-même. Il souhaitait que ce garçon ne fût réellement pas dans le train et ne revînt pas à Saint-Claude. L’idée lui paraissait odieuse, et, en même temps, raisonnable. Il mettait tous ses espoirs dans cette amitié et il aurait voulu qu’elle ne fleurît jamais, comme si elle devait produire des complications plus graves que celles dont Lucien et André avaient souffert.
Pendant qu’on remontait vers Saint-Claude, Maurice vint remercier Georges de sa lettre. Au loin, courait le vrai destinataire de ce message. On le voyait lancer des boules de neige, escalader les talus, faire des glissades sur les ruisseaux gelés, regagner en jouant ce collège où l’attendaient peut-être des épreuves qu’il ne soupçonnait pas.
Ainsi que l’indiquait le règlement, la communauté se réunissait dans l’étude des petits, « pour offrir ses souhaits à M. le Supérieur et à MM. les Professeurs ».
Un élève de philosophie lut un compliment, auquel le supérieur répondit par le commentaire de la devise bénédictine : Ora et labora. Georges avait reconnu, à l’extrémité du quatrième rang, du côté de la cour, l’enfant dont l’image régnait dans son âme. Il ne le voyait que de dos, et, de temps en temps, de profil : il n’en était pas moins ravi.
« La prière ne nuit jamais au travail, disait le supérieur, et c’est pourquoi nous vous faisons prier le plus possible. Le temps que l’on consacre à Dieu n’est jamais perdu. Lorsque saint Raymond Nonnat, encore simple pâtre, était en oraison, un ange veillait sur son troupeau et mettait les loups en fuite. »
On se rendit au salut. Georges était inquiet à la pensée d’un changement de places chez les petits. Il bénit le ciel, quand l’enfant s’agenouilla au même endroit qu’auparavant.
Les ornements liturgiques étaient blancs, mais le premier salut de l’année n’avait pas à envier à la première messe d’octobre les couleurs de l’amour. Il n’y avait pas seulement, comme à l’ordinaire, la lampe rouge de l’autel ; une crèche avait été dressée dans la nef pendant les vacances et toutes les lampes qui l’éclairaient étaient rouges. Elles rappelaient à Georges un passage du Cantique des Cantiques, qu’il avait noté dans son carnet : « L’amour est fort comme la mort, son ardeur inflexible comme l’enfer, ses lampes sont des lampes de feu et de flammes. » Amour et amitié, n’était-ce pas la même chose ? Les vers de Fersen disaient aussi : « Ami… Amour… » Et le noël qu’entonnait la schola ne chantait que l’amour. Le Saint-Esprit était « esprit d’amour » dans le cantique de l’autre rentrée. Rares avaient été les conférences et les instructions de la retraite qui n’eussent pas fait allusion à l’amour. Georges avait souri alors de ce mot-là, mais il le comprenait aujourd’hui : on ne l’aurait pas prodigué en vain.
Oui, en cette minute, au milieu de ces chants, de ces lumières, de cet encens, il avait aboli ses dernières appréhensions. Il se jurait de conquérir celui que le destin avait mis en sa présence, vivant défi de la beauté.
Le lendemain matin, il fut surpris de ne pas voir à son banc celui en l’honneur de qui il avait particulièrement soigné sa tenue. Il l’aperçut dans la tribune en face, servant la messe au père Lauzon. Cela lui rappela que Maurice avait rempli le même rôle avec ce père, pendant plusieurs semaines avant les vacances. Mais un service de cette durée était exceptionnel. Celui de l’enfant ne serait sans doute que d’un jour, ou tout au plus d’une huitaine : c’étaient les deux cas les plus fréquents.
Au moins, la messe était en rouge (octave des Saints-Innocents). Les promesses d’hier au soir se confirmaient. Mais qu’annonçait, d’autre part, cette fête des Saints-Innocents ? Le jeune acolyte du père Lauzon n’y figurait-il que par ironie, comme Lucien avait figuré au salut de la Saint-Placide ? Il était peut-être encore un innocent, mais il était trop beau pour être un saint.
Les messes privées finissant avant la messe publique, qu’allongeaient les communions, Georges surveillait la tribune. Il voulait que l’enfant descendît bientôt, et il trouvait le père Lauzon d’une longueur insupportable. Ensuite, lorsque celui-ci eut terminé, Georges regrettait que l’enfant ne se dépêchât pas davantage d’éteindre les cierges et de couvrir l’autel. La petite tête passa une dernière fois derrière la balustrade, pendant que le père, dépouillé des habits sacrés, se remettait en oraison. La porte de la tribune s’ouvrit, puis celle du transept, et l’enfant, sur la pointe des pieds, vint rejoindre ses camarades. Il ne se croyait pas dispensé de suivre la messe du supérieur par celle qu’il venait d’entendre ; il lut les dernières prières avec attention. Peu après, le claquoir retentissait — c’était la sortie.
Même scène le lendemain : la comédie de la tribune continuait. Même scène encore, et le jour suivant, et le samedi. Seule, la soirée de la veille avait apporté quelque compensation : c’était le premier vendredi du mois, et, selon l’usage, il y avait salut du saint sacrement. Georges avait eu vingt bonnes minutes pour amuser son appétit.
Il se rassurait d’ailleurs. L’enfant en terminerait sans doute avec la semaine. La messe basse de ce dimanche de l’Épiphanie serait la dernière que celui-ci aurait entendue là-haut. Déjà, en heureux présage, il se trouvait à sa place durant la grand-messe. « Ecce advenit… Il est venu ! » disait le texte. Mais c’est en pure perte que Georges répandit l’or, l’encens et la myrrhe. Il n’obtint pas la grâce d’un regard, avec tous les présents des Rois. Vainement essaya-t-il de se faire remarquer en laissant tomber son livre, puis en se donnant une quinte de toux. Il dut se contenter de ce que l’enfant offrait à la vue de chacun : ses lignes pures, ses attitudes élégantes, ses gestes gracieux, le mouvement de ses lèvres qui priaient.
Il était un peu dépité de tant de zèle pour les choses du ciel. N’importe : comme un héros antique, il se sentait prêt à combattre même les dieux.
Il fut le premier en version grecque. Mais les résultats de sa classe lui importaient beaucoup moins que ceux de la cinquième. Il attendait un nom, qui allait envelopper le réfectoire d’une douceur exquise. Le petit Motier était septième sur vingt-deux. Ce n’était pas mal, après tout.
Aucun succès à vêpres, mais Georges restait confiant. « L’amitié est comme le génie, se disait-il : une longue patience. »
Pendant les solennités d’aujourd’hui, les diacres, les acolytes s’étaient sans cesse interposés, contrecarrant son magnétisme. Aux messes basses de la semaine, rien ne le gênerait. Georges était impatient que ce dimanche finît. Il se donnait huit jours pour obtenir un sourire de cet enfant, et regarda son calendrier afin de vérifier les dates.
Pauvre Lucien ! Il l’aurait échappé belle. Georges avait failli oublier de lui présenter ses vœux de bonne fête. Aujourd’hui, 8 janvier, c’était non seulement le report de l’Épiphanie, mais la Saint-Lucien. À la méditation, ce matin, le supérieur n’avait parlé que des Rois Mages.
Le lendemain, il s’agissait de saint Julien d’Antioche qui, en se rendant au supplice, avait converti le jeune fils de son persécuteur : ce garçon était sorti de l’école pour assister au spectacle et, tout à coup, jetant ses livres et arrachant sa tunique, il courut auprès du martyr et périt avec lui.
Voilà donc sous quels auspices débuterait tout à l’heure une entreprise de séduction en pleine église.
Hé quoi ! la gageure durait encore. L’enfant aidait l’éternel père Lauzon à revêtir les éternels ornements rouges. Georges n’était pas seulement déçu et furieux. Il commençait d’être inquiet : tant d’assiduité n’indiquait-elle pas que l’on se destinait à la prêtrise ? Il voyait dans cette raillerie du sort une répétition de ce qui lui était arrivé au premier trimestre avec Lucien. Des pensées attristantes l’envahirent. Il lui semblait que le bonheur si ardemment souhaité serait insaisissable. Mais non, un tel déni de justice n’était pas permis !
À la première récréation, il demanda à Maurice un renseignement pour la classe de mathématiques qui allait suivre, et, comme si cela le faisait penser au professeur, il ajouta :
« Tu ne sers plus la messe au cher père ?
— Merci bien, répondit Maurice. J’ai passé la main au cher frère.
— Vous vous relayez ?
— Merci encore ! J’ai fait mon mois, à lui de faire le sien. C’est ma mère qui a voulu ça. Elle est très pieuse, naturellement, et il lui plaît que ses deux enfants servent la messe, l’un en janvier, l’autre en décembre : voilà pourquoi nous ouvrons et fermons l’année en disant amen au père Lauzon — il est l’intime de nos parents.
— Parfait ! À votre place, je me méfierais de lui. Vous serez tonsurés avant de vous en être aperçus, comme des fils de rois mérovingiens.
— Sois tranquille, dit Maurice en riant. Nous ne sommes pas fils de roi, mais fils de médecin, et nous avons la tête solide. Tu es bien gentil, d’ailleurs, de t’intéresser à notre sort ; aussi, je te prêterai les vers de Richepin. »
Ces vers, dont Georges avait déjà entendu parler, étaient extraits du recueil : Les Caresses. Ils circulaient entre quelques initiés qui, disait-on, les transcrivaient dans les marges de leurs missels, afin de les apprendre par cœur durant les offices — liberté moins digne du grand siècle que du siècle suivant. Jusqu’à présent, Georges s’était montré peu curieux de ces vers. Il en était resté à ceux de Rostand et de Fersen. Néanmoins, il tenait à ménager l’amour-propre de Maurice et le remercia de son obligeance.
« En classe, ajouta-t-il, je te soufflerai les leçons. »
Chaque matin, pendant la messe, il regardait la tribune, avec un intérêt qui désormais ne s’alarmait plus. Lorsque l’enfant était agenouillé, la balustrade le cachait, mais Georges savait à quels moments il allait le voir debout : à l’évangile, à l’offertoire, à la consécration, de nouveau après la communion, etc.
Ces petits plaisirs quotidiens lui faisaient prendre patience, et la chapelle tenait désormais la place d’honneur dans sa vie. Il avait accueilli comme une récompense le chemin de croix rituel du troisième vendredi, et il aurait voulu un salut du saint sacrement chaque soir, comme il y en avait au temps de la retraite. Maintenant, rien ne lui était plus délectable que les cérémonies du dimanche. La grand-messe, les vêpres, qu’il trouvait jadis si fastidieuses, étaient, à son gré, devenues trop courtes.
Au réfectoire également, ses souhaits avaient changé : il aimait moins le Deo gratias qui permettait cependant de bavarder avec Lucien, et il préférait le calme de la plus ennuyeuse lecture. Mieux que dans le tumulte de la conversation, il se sentait alors plus proche de l’enfant, et, le plus souvent qu’il le pouvait, tournait la tête vers sa table. Là aussi, avant le déjeuner dominical, il entendait une lecture qui le payait de toutes les autres : celle d’un simple nom, dans la liste des compositions de la semaine. C’était le nom qu’il se redisait de temps en temps à lui-même, comme naguère celui des dieux. Lorsque ces deux syllabes désignaient le frère aîné, elles lui paraissaient banales et le laissaient indifférent. Elles lui faisaient battre le cœur et lui semblaient délicieuses, quand elles désignaient le plus jeune. Il regrettait pourtant que, dans cette circonstance, les prénoms ne fussent pas dits avec les noms : il aurait voulu savourer de même celui de l’enfant et n’osait le demander à Maurice. Il se plaisait parfois à s’imaginer que ce prénom fût Georges.
Les places du petit étaient toujours honorables aux compositions, mais Georges détestait ceux qui étaient avant lui. Il jugeait leur primauté misérable, à côté de la sienne. En revanche, il tenait, lui, plus que jamais, à être le premier. Il espérait ainsi graver son propre nom dans l’esprit de cet enfant, le lui rendre même sympathique. Depuis qu’il savait à qui dédier ses succès, il travaillait avec une ardeur nouvelle. En mathématiques, au contraire, il renonça à des efforts superflus et, afin d’avoir, là aussi, des notes encore meilleures, il copia plus fidèlement sur Lucien.
Un projet de dissertation française avait été le suivant : « On vous offre un voyage à l’étranger. Quel pays choisiriez-vous ? Et pour quelle raison ? » Georges avait choisi la Grèce.
En écrivant, il pensait à la mythologie, aux statues antiques, à la monnaie d’Alexandre, et il évoqua même l’image de ce héros. Mais il songeait surtout à l’enfant qui incarnait aujourd’hui la beauté dont les Grecs avaient eu le culte.
La note fut excellente et le Tatou mit cette appréciation : « Vivant, intéressant. Votre enthousiasme est réfléchi. Qu’il reste toujours raisonnable et éclairé. » Après avoir, en somme, critiqué le choix de Lucien comme modèle du « Portrait d’ami », il approuvait le nouvel « enthousiasme ».
Ce fut ainsi que Georges put remettre au supérieur les cinq devoirs nécessaires pour sa candidature académique. S’il n’y avait pas d’anicroche, la noble compagnie lui ouvrirait ses portes au début de février. Le résultat des élections était publié au réfectoire, le premier dimanche du mois — Georges n’avait vu cette cérémonie qu’une fois depuis qu’il était ici. Rien de plus glorieux : l’élu, applaudi de tout le collège, se levait et s’inclinait en remerciement. Février s’annonçait plein de merveilles : l’enfant serait descendu de sa tribune et c’est pour se présenter à lui dans les formes que Georges allait être académicien. L’académie de Saint-Claude n’était plus l’antichambre de l’Académie française, elle n’avait été fondée qu’afin d’attirer sur quelqu’un l’attention d’un enfant.
En redescendant de chez le supérieur, Georges passa par la cour intérieure, au lieu de suivre les couloirs. Il s’approcha de l’étude des petits, dont les fenêtres faisaient une tache claire dans la nuit.
La buée du poêle couvrait les vitres, mais laissait distinguer au moins les visages les plus rapprochés. On pouvait voir sans être vu. À côté de la deuxième fenêtre, le frère de Maurice écrivait. Comme il se tenait bien ! On eût dit qu’il posait devant un peintre ; et, en même temps, il était tout naturel. Sa jambe brillante s’écartait dans l’allée, hors du pupitre. Interrompant son travail, il mordilla son porte-plume et leva la tête pour réfléchir : l’inspiration ne venait pas. Doucement, il se tourna vers la fenêtre. Ses yeux se fixèrent, sans le savoir, sur ceux de Georges.
Ce dernier, de retour en étude, voulut exprimer littérairement sa joie. C’était lui qui était inspiré. Il songea à son « Portrait d’ami », le portrait raté : l’occasion était bonne de le refaire. Cette fois, il décrirait vraiment « l’ami de son cœur ». Il utilisa, par discrétion envers Lucien, l’écriture abrégée dont il griffonnait ses brouillons, et qui était indéchiffrable pour tout autre que lui. Il ne fut pas mécontent de son travail. Le « Portrait d’ami » était devenu le portrait de l’Amour de Thespies en personne. Voilà le seul devoir qui eût mérité les honneurs académiques.
Tout cela allait bel et bien, mais à quoi aboutissait-on ? La division opposait ses barrières. Le mot de « division » aussi, Georges le comprenait à présent. Quand même cet enfant et lui passeraient l’éternité face à face dans la chapelle, ils n’arriveraient jamais à lier connaissance. Georges avait cherché à se consoler en pensant à l’année prochaine, qui les réunirait chez les grands, mais cette éventualité était bien lointaine. D’ailleurs, qui pouvait savoir s’ils reviendraient l’un et l’autre à Saint-Claude ? (Une raison quelconque les en empêcherait peut-être — à la rentrée de janvier, certains de leurs camarades n’avaient pas reparu.) Et maintenant qu’ils se trouvaient ensemble, ils n’arriveraient donc pas à échanger deux mots ! Les obstacles n’étaient rien, pas plus que la vitre de l’étude ou les dalles du chœur, mais ils étaient infranchissables. Non moins que le matin où il avait cru que l’enfant désirait être prêtre, Georges se reprenait à douter. Il fut tenté de se confier à Lucien, mais y renonça : ses peines n’étaient pas de celles qui se partagent, et d’ailleurs, n’aurait-il pas plus de mérite à trouver seul le remède ?
Il voulut avoir tout essayé. Imaginant possible une rencontre fortuite, il se mit, durant les études, à visiter ses professeurs à tour de rôle. Il allait emprunter des livres qu’il ne lisait pas, demander des explications qui ne lui importaient guère. Il flattait la manie du vieux professeur d’histoire et d’instruction religieuse, en prétendant s’initier à l’élevage des vers à soie. Il entendait à ce sujet les opinions de M. de Quatrefages, que le père aimait citer, et affectait aussi une passion pour les souris blanches.
Mais surtout, il s’inventait des scrupules de conscience, afin d’avoir libre accès auprès du père Lauzon — sans doute le petit Motier se rendait-il familièrement chez celui-ci. Avant comme après ces visites, Georges attendait dans le couloir du premier étage, feignant d’admirer les photographies collectives, encadrées sur la muraille avec mention de leur date : la plus récente remontait à trois ans, et l’enfant n’y figurait pas.
Pendant la récréation où se donnaient les divers soins à l’infirmerie, il ne manquait pas de s’y rendre sous divers prétextes. Il pensait aux engelures qu’il avait traitées en compagnie de Lucien. Il lui en voulait presque d’avoir épuisé sa chance du côté des maladies.
Enfin, ce jour arriva où l’enfant resta en bas de la chapelle, et la joie de Georges fut si grande qu’il oublia tous ses chagrins. Premier février : saint Ignace. Saint Ignace avait remplacé saint Julien pour cette entrée en matière. Georges se rappelait le refrain d’une chanson ancienne : Le mariage démocratique ou Les noces de la fille du président Fallières, chanson dénichée par ses cousines, qu’amusaient les noms prêtés aux invités de ces noces, parmi lesquels ceux-ci :
Le grand-père Ignace,
Le cousin Pancrace,
L’oncle Célestin.
« Dans deux générations, avait dit Georges à Liliane, ton nom à toi fera un effet aussi comique. »
Naturellement, saint Ignace était vêtu de rouge.
L’enfant était toujours aussi sérieux, lisant ses prières, contemplant l’autel, semblant avoir fait vœu de ne jamais regarder celui qui le regardait sans cesse. Comme le matin du départ de Noël, il n’y eut que Lucien entre eux à la communion. Mais, là encore, aucun moyen de franchir l’obstacle. Après s’être refusé à solliciter les conseils dudit Lucien, Georges se refusait à solliciter sa complaisance. Et c’était, là encore, par goût du secret autant que par amour-propre.
Le lendemain jeudi, le supérieur annonça à M. et Mme de Sarre, venus pour la sortie du mois, que leur fils était élu académicien. Georges fut content. L’enfant avait beau s’obstiner à ne pas le regarder à la chapelle, il serait bien obligé de le regarder au réfectoire, quand on le proclamerait académicien.
Dimanche. La couleur verte des ornements sacrés, tous ces dimanches qui suivaient l’Épiphanie, ne pouvait avoir été trompeuse : l’espoir prenait corps aujourd’hui.
Georges, dont le nom venait de retentir, se leva pour saluer. Il se tourna vers le supérieur ; mais, en même temps, il posa les yeux sur celui à qui il faisait hommage de son triomphe. Et le soir de ce grand jour, c’est encore à lui qu’il pensait, en se rendant avec ses nouveaux collègues à sa première séance académique. Il le mettait au-dessus de toutes les gloires, mais il aurait souhaité lui voir connaître celle-là. Il comprenait que Marc n’y fût pas demeuré insensible.
Les académiciens traversèrent dignement la cour intérieure et montèrent aussi dignement le grand escalier. Mais ce fut une bousculade à la porte de l’antichambre : chacun de ces messieurs voulait s’emparer d’un fauteuil. En effet, ils étaient quinze pour huit sièges, et ces sièges, bien que très durs, représentaient un avantage, faute duquel il ne restait que la banquette.
À l’écart, les trois philosophes observaient dédaigneusement cette compétition. Lorsque tout leur monde fut pourvu, ils frappèrent à la porte de M. le supérieur, et entrèrent paisiblement, comme chez eux. Ils avaient le privilège des trois fauteuils vacants dans le bureau, et qui étaient à ressorts. Leurs collègues les suivaient, portant les uns des fauteuils, les autres la banquette.
À genoux, on récita une dizaine de chapelet, puis on se remit sur pied, et le supérieur confirma Georges dans son élection en lui délivrant son diplôme. C’était une feuille de bristol ornée de médaillons représentant les grands hommes du siècle de Louis XIV. L’emblème du roi-soleil rayonnait sur le nom de l’académicien. Le supérieur dit quelques mots en guise de discours de réception. Il ne manqua pas de citer les deux anciens élèves dont s’enorgueillissait le collège, et qui avaient été académiciens de Saint-Claude, avant d’entrer à l’Institut.
On s’assit. Georges n’était pas fort à l’aise sur sa banquette. Il espérait qu’au Palais Mazarin, le fauteuil d’Anatole France serait plus confortable.
Le supérieur lut un sonnet dont il était l’auteur, La fermière. À cet énoncé, plusieurs académiciens s’étaient regardés en souriant malignement. Georges savait déjà que le supérieur composait des sonnets pendant les vacances, et qu’il les lisait dans les séances de l’académie. La fermière se terminait ainsi :
Quand tu rentres, le soir, du champ ou de l’étable,
L’odeur de tes vertus embaume la maison.
Un académicien parla ensuite de la duchesse de Montausier. On n’avait fait qu’un saut, de l’étable à l’Hôtel de Rambouillet. Puis on en vint à Bossuet, dont la seconde partie de ces réunions constituait l’apanage.
Quelqu’un commença la lecture de l’Oraison funèbre de Nicolas Cornet, grand-maître du collège de Navarre. Le supérieur s’était élevé contre cette théorie que le texte n’en fût pas authentique : il y trouvait des beautés singulières, qu’on se devait de réhabiliter. Sans doute aussi était-il heureux qu’un supérieur de collège, ennobli du titre de grand-maître, eût inspiré l’éloquence de l’Aigle de Meaux, et croyait-il que cela toucherait également des collégiens.
Il s’était carré dans son fauteuil, mais promenait sur les autres un regard vigilant. Il avait croisé les jambes, montrant ses grosses chaussettes. Sa main jouait avec un coupe-papier de cuivre, ciselé dans un éclat d’obus, et où était gravé : « Dieu et la France. » De temps en temps, il en frappait le bras du fauteuil pour arrêter le lecteur : il soulignait une expression, commentait une pensée, et concluait chaque fois par cette phrase : « N’est-ce pas, messieurs ? » Tout le monde hochait la tête en signe d’approbation.
Par réaction contre l’oraison funèbre, Georges pensait aux vers des Caresses, que Maurice lui avait donnés à lire et qui ne lui paraissaient pas de très bon goût :
L’amour qu’il me faut, l’amour qui me cuit…
Pourtant, Richepin avait été de l’Académie française, comme Bossuet. Dans leur studieuse jeunesse, n’avaient-ils pas été de quelque académie de Saint-Claude ?
Le lendemain, à la messe, l’enfant jeta un coup d’œil : il avait reconnu, évidemment, le héros de la veille. Il savait son nom, et même son prénom, puisque la proclamation académique n’omettait rien ; et si, par chance, il s’appelait Georges, peut-être qu’il faisait, lui aussi, le rapprochement de leurs prénoms. Mais, en face de lui, Georges se disait bien autre chose : c’est que, tout à l’heure, à la communion, se ferait un rapprochement plus intéressant, celui de leurs personnes. Lucien, qui se délestait de ses bonnes œuvres, avait dû provisoirement montrer un peu de zèle en manière de compensation : il avait demandé à répondre la messe toute une semaine, et on venait de lui faire commencer son service aujourd’hui. Grâce à son absence, ses deux voisins de sainte table deviendraient voisins immédiats.
Georges s’abandonna au charme dont le remplissait cette perspective. Il comptait obtenir enfin un avantage positif. Il ne savait encore par quel moyen, mais il savait qu’il ne laisserait pas échapper cette occasion unique. Deux destinées allaient dépendre de ce que serait un bref moment pendant quelques matins.
Pris de court cette fois, Georges se rendit à la communion sans avoir rien préparé. D’ailleurs, l’enfant était resté trop recueilli pour s’apercevoir, sans doute, qu’il y eût du nouveau.
Le jour suivant, Georges avait espéré se signaler à son attention en s’inondant les cheveux de lavande, mais que faisait la lavande à un enfant qui communiait de tout son cœur ? C’est ce dernier qui était dans le vrai, en ne pouvant supposer qu’on osât se servir, à des fins suspectes, d’un pareil lieu et de pareils instants. Georges lui-même avait eu quelque mal à s’endurcir sur ces scrupules. « Mais, se dit-il, qui veut la fin veut les moyens. » Ce n’était pas sa faute : il n’y avait que ce moyen-là. Néanmoins, il se demandait si l’enfant raisonnerait comme lui, et il craignait de scandaliser au lieu de séduire. Maintenant, il attendait chaque communion avec anxiété. De nouveau, le plaisir espéré s’était changé en tourment.
Le mercredi, Georges avait frôlé le coude de l’enfant en soulevant la nappe, et recommencé le lendemain d’une façon plus caractérisée. Il se sentait vexé que l’on continuât d’ignorer sa présence.
Le vendredi — c’était le 10 février, il nota le jour — il s’était promis d’avoir raison de tant de gravité. Cette sorte de résistance l’exaspérait. Il avait décidé de voir enfin qui serait victorieux. La lutte était ouverte entre l’ange gardien et l’Amour de Thespies.
Avant la communion, il contemplait, avec une tendresse ironique, cet enfant absorbé par ses patenôtres et ne perdant pas une syllabe de la messe de sainte Scholastique, vierge. Ah ! on allait l’asticoter, le jeune écolier vierge ! Puisqu’il avait toujours l’air de tenir son agneau, on le lui ferait lâcher d’un bon coup.
Georges pressa fortement de son bras l’enfant qui venait de s’agenouiller à côté de lui. Il s’était cru plein de sang-froid et fut effrayé de s’être permis ce geste, qu’il avait imaginé moins troublant. Celui des matins précédents était peu de chose, l’insistance de celui-ci le rendait presque sacrilège. Il tardait à Georges d’avoir regagné son banc pour se mettre le visage entre les mains, suivant le rite du respect, et observer entre ses doigts. L’enfant était sans doute rouge de confusion.
Comment ! il était en prières ! C’était donc un pur esprit ! On ne pouvait émouvoir que des êtres de chair. Le sacrilège avait fait long feu. Mais avant que Georges eût réfléchi davantage sur cet événement, il vit l’enfant se découvrir les yeux et le regarder. Ce regard marquait l’étonnement — et un étonnement sans bienveillance. On s’était mépris manifestement sur la démonstration de tantôt : on jugeait M. de Sarre assez mal élevé. Bien que déçu, Georges se réjouit que la réaction n’eût pas été plus profonde. Cela le libérait.
Samedi : dans deux jours, le retour de Lucien aurait mis fin à ces belles communions, et il n’y avait plus de temps à perdre pour dissiper toute équivoque. Rapidement, avec le bras, Georges donna plusieurs petits coups à l’enfant. Ce dernier pourrait-il encore n’y voir qu’un trait de mauvaise éducation ? Lorsqu’il fut à son banc, et avant même de se recueillir, il examina Georges d’un air intrigué. Sans doute commençait-il à soupçonner que cette plaisanterie signifiait quelque chose.
Pour la clôture, Georges avait imaginé une manifestation différente, de manière à ne plus laisser le moindre doute possible.
Pendant tout le temps qu’il resta à la sainte table, il balança son genou contre celui de l’enfant. Il avait fait l’essai de cette attitude sur sa descente de lit.
Le succès avait été complet. Aussitôt revenu à sa place, l’enfant considéra son agité vis-à-vis ; plus d’une fois, avant la fin, leurs regards se rencontrèrent. Georges songeait à lui sourire, mais avait peur de ne pas recevoir de réponse. Un sourire n’excuserait pas ses procédés, si ses intentions n’étaient pas entièrement comprises. Il lui fallait d’abord se faire entendre, et le sourire viendrait tout seul sur les lèvres de l’enfant.
La grand-messe les mit définitivement aux prises. Georges, de temps en temps, lisait, par contenance, quelques lignes de l’office de la Septuagésime. On entrait, en effet, dans « le temps de la Septuagésime », comme le supérieur avait dit. Les ornements verts des autres dimanches avaient fait place aux ornements violets, signe de pénitence. Mais l’espoir, au contraire, habitait plus que jamais le cœur de Georges. Ce n’était pas pour lui que figurait le De profundis dans les textes du jour. Il eût chanté plutôt : Alleluia ! O Paian ! Evoe Bacche !
Mais qu’est-ce que l’enfant devait penser d’un garçon aussi peu respectueux des choses saintes, et qui n’avait d’égards — et d’étranges égards — que pour lui ? Quoi qu’il pensât, il en savait maintenant sur cet académicien plus que l’autre dimanche.
Georges était de nouveau premier en composition. Il s’en réjouissait. L’enfant ne pourrait qu’être assez fier d’inspirer de l’intérêt à un élève toujours aussi brillant, major de la classe de son frère et porteur d’un joli nom. Quant à lui, il fut second de son côté. Cette place représentait un grand progrès, et Georges aimait à penser que ç’avait été en composition française. Il y voyait un nouveau signe favorable, comme si les Muses devaient présider à leur commerce.
Pendant la récréation d’une heure, il n’en était pas moins angoissé ; il guettait le retour de Maurice qui était allé voir son cadet, suivant la permission qu’en donnait le règlement chaque dimanche. Jusqu’à présent, Georges avait aimé ces visites, d’où l’on semblait lui rapporter quelque chose de l’enfant. Il aurait souhaité, à l’inverse, que celle d’aujourd’hui n’eût pas lieu, se demandant si l’enfant ne parlerait pas de ses manœuvres. L’abord de Maurice lui prouva bientôt que ses craintes étaient vaines : le secret avait été gardé ; mais était-ce pudeur ou complicité ?
À la communion de ce lundi matin, Georges ne s’était plus trouvé auprès de l’enfant, qui l’avait regardé ensuite avec surprise. Pour lui donner à deviner la raison de ce changement, Georges tourna la tête vers Lucien qui était revenu. L’enfant se douterait qu’ils devaient cacher leur intrigue à ce voisin, comme lui-même l’avait cachée à son frère. En tout cas, l’expression de son visage avait été l’épreuve que l’on attendait.
Évidemment, cet enfant était déjà en coquetterie avec Georges, mais jusqu’à quel point le savait-il ? Ses regards étaient fréquents, mais encore incertains. On voyait pourtant que, malgré son affectation à suivre la messe, il était moins attentif. Georges avait relevé un autre détail qui n’était pas sans valeur : les boucles vagabondes étaient admirablement peignées aujourd’hui.
Le lendemain, à la sainte table, Georges réussit à passer devant Lucien, après l’avoir bousculé.
« Qu’est-ce qui te prend ? murmura celui-ci.
— Il faut varier un peu : Variation brillante. »
L’enfant avait dû se rendre compte que la tactique n’avait pas été sans hardiesse, et juger qu’elle était digne de récompense : de retour à son banc, il avait souri. Avec quel bonheur Georges avait accueilli ce sourire et l’avait rendu ! Il ressentait aussi quelque orgueil d’être parvenu à ses fins, d’avoir réglé savamment la gradation de cette affaire. Il éprouvait l’ivresse du triomphe, du plus cher de ses triomphes. Il lui semblait naître maintenant à la vie.
En même temps, il reprenait place en apparence dans la communauté. Désormais, il serait bien obligé de lire les offices, puisqu’il ne pouvait plus rencontrer les yeux de cet enfant sans lui sourire. Il devrait même éviter de se retrouver près de lui à la communion. À quoi bon courir le risque de se faire remarquer l’un ou l’autre, dès lors que le contact était établi ? Il leur était permis d’apaiser leur fièvre ou leur émoi : le résultat essentiel était obtenu.
La semaine s’écoulait paisiblement. Les regards de Georges, chaque matin, s’emparaient de ceux de l’enfant, une fois pour toutes, puis c’était la lecture du missel.
Il se plaisait à trouver dans la liturgie quotidienne un aliment de tendresse. Ce qui avait été un divertissement d’occasion était devenu sa règle : les choses divines étaient à présent humaines. Il faisait siennes ces paroles, dans le propre des saints de ces jours-là : « Vous avez posé sur ma tête une couronne de pierres précieuses », ou : « Dans ta splendeur et ta beauté, viens, triomphe et règne. » Il y avait aussi d’autres sentences qu’il appréciait moins : « Heureux l’homme qui craint le Seigneur ! » « La concupiscence enfante le péché, et le péché, lorsqu’il est consommé, engendre la mort. » L’enfant qui lisait ces textes, les voyait-il sous le même aspect, et par lesquels était-il le plus touché ?
Dimanche de la Sexagésime. Georges, en allant à la chapelle, se répétait, comme un exercice de diction, le nom de ce dimanche, que le supérieur avait écorché deux ou trois fois pendant son discours matutinal.
En l’honneur de la Sexagésime, l’enfant avait mis une cravate rouge qui paraissait toute neuve. Il devait avoir noté que Georges, le dimanche, en portait une pareille, avec son uniforme bleu. Mais il ignorait, sans doute, qu’il arborait la couleur de l’amour. Quelques instants avant la communion, il ferma son livre et regarda Georges gravement — attendait-il cette minute ?
À la sainte table, il passa lestement derrière Lucien, qui fut ainsi écarté, comme mardi, et son coude s’avança à la rencontre de Georges, Le voile blanc trembla légèrement sur leurs mains qui le soutenaient.
Georges s’en voulait de gâter par une réflexion les délices qui le ravissaient : ne s’agissait-il pas d’une gaminerie ? C’est probablement l’hypothèse que Lucien retenait pour son propre compte, puisqu’il n’avait fait aucune remarque sur ce nouvel incident.
L’enfant était troisième à la composition d’histoire, et Georges avait été second. Ils étaient descendus d’un cran, chacun dans sa classe.
Georges pensait à la série qui allait suivre (géographie, mathématiques, sciences naturelles) et qui continuerait de le faire glisser sur la pente — il était difficile de copier, dans ces occasions-là. Quelle chance, du moins, qu’au moment où il avait eu besoin de prestige, l’ordre des compositions eût été en sa faveur ! Maintenant, il s’en moquait : les couronnes du collège pouvaient disparaître devant la couronne de pierres précieuses.
Quand la lecture des résultats fut terminée, il se tourna vers l’enfant. Tous deux avaient eu la même pensée. Le réfectoire, désormais, connaîtrait aussi leurs sourires.
Au début de la récréation d’une heure, Lucien venait de se rendre au piano, et Georges suivait des yeux Maurice qui partait pour sa visite habituelle, lorsqu’il se crut le jouet d’une illusion, en voyant arriver son frère.
Maurice ne parut pas moins étonné ; il n’était certainement pas habitué à ce qu’on lui témoignât tant d’empressement. Il emmena le petit dans un coin de la cour et lui donna à lire une lettre ; mais, souvent, celui-ci levait la tête, comme à la chapelle, semblant chercher quelqu’un. Enfin, il aperçut Georges, mais ne lui sourit pas.
Georges n’osait approcher. Il avait été arrêté par un regard si sérieux, mais quand ce regard, avec le même sérieux, se fut de nouveau posé sur lui, il en comprit la signification : l’enfant était venu pour lui seul, et cette démarche, qui aggravait celle de ce matin, lui confirmait sa conquête.
Voilà que Maurice s’impatientait et faisait mine de reprendre la lettre : le frérot n’en finissait pas de lire ; peut-être n’avait-il rien lu et se disait-il anxieusement : « Est-ce qu’il ne viendra jamais, l’autre ? Ce qu’il doit faire est pourtant moins difficile que ce que j’ai fait. »
Georges, saisissant la balle que Lucien lui avait laissée, la lança dans la direction qu’il fallait et courut la chercher. Maurice l’attrapa et allait la lui renvoyer, mais l’enfant la fit tomber d’un geste prompt. Cette fausse espièglerie répondit au stratagème de Georges, qui put ainsi ramasser la balle tout près d’eux.
« C’est ton frère ? demanda-t-il à Maurice, en désignant l’enfant.
— Quoi ! vous ne vous connaissez pas, et vous avez la même cravate ? »
Ils rougirent l’un et l’autre : la couleur de leurs cravates avait passé sur leurs joues.
Maurice, prenant un air pompeux, dit à Georges :
« Je te présente le petit Alexandre, qui deviendra grand, élève de cinquième, âgé de douze ans et demi, congréganiste de la Très Sainte Vierge, et aujourd’hui troisième en histoire, pour faire honte à son aîné.
« Et à toi, dit-il à l’enfant, je te présente l’héritier présomptif du marquisat de Sarre et autres territoires, académicien diplômé et collectionneur ordinaire des premières places. »
Ils se mirent à rire. Georges serra la main de l’enfant. Il était troublé de toucher ces doigts minces. Il gravait dans son cœur ce visage, caressé déjà par tant de regards, par tant de pensées. Le soleil de février enveloppait l’enfant de rayons frileux. Les yeux, que Georges voyait si bien à présent, étaient du même or que la chevelure. Une mèche rebelle tomba sur eux, comme pour les voiler ; l’enfant la rejeta en arrière, d’un aimable mouvement de tête. Était-ce à dessein de parfaire sa beauté qu’il venait d’aviver l’éclat de ses lèvres avec le bout de sa langue ?
Georges ne se sentit pas l’audace de lui adresser la parole. Se tournant vers Maurice, il dit, faute de trouver quelque chose de spirituel :
« Tu méritais sûrement une meilleure place en histoire. »
L’enfant, dont les yeux rieurs brillaient dans le soleil, regarda son frère, et sa voix légère fit entendre ces mots :
« Il est gentil de te dire ça. »
Durant la promenade, Georges fut extrêmement gai. Il aurait voulu embrasser Lucien. Il demanda des détails piquants sur les grandes vacances avec André ; mais Lucien, de nouveau réticent, prétendit que la lettre de Noël en avait assez raconté. On voyait qu’il tenait à éviter des évocations de cet ordre. Il prenait amicalement ses précautions. Georges avait envie de lui dire qu’il pouvait désormais être tranquille. Ce n’est pas pour lui-même qu’il aurait été embrassé.
Le sonnet du dimanche était intitulé : Le rossignol.
Dans le calme serein de la nuit argentée…
Pendant l’oraison funèbre de Nicolas Cornet, dont se poursuivit la lecture, le supérieur trouva que le lecteur manquait de nerf.
« Allons, monsieur Un Tel, dit-il, mettez un peu de vie dans votre lecture. »
Bientôt, il n’y tint plus. Saisissant le livre, il déclama le texte lui-même, comme s’il allait s’envoler, avec l’Aigle de Meaux, par la fenêtre.
Aujourd’hui, mieux encore que la première fois, Georges eût aimé voir l’enfant dans cette assemblée. Mais c’était afin de rendre, par sa présence, cette assemblée supportable. Sans lui, l’académie n’était qu’une pauvre farce, dont les lauriers dérisoires n’auraient eu de grâce que sur son front. Peut-être, d’ailleurs, qu’il les méritait. Il avait été second en composition française, et sa classe, la dernière à pouvoir être représentée dans ce cénacle, y comptait actuellement un seul élève. Le petit Motier n’était-il pas un candidat tout désigné ? On ferait campagne en sa faveur, on découvrirait mille beautés dans chacun de ses cinq devoirs. Georges serait entré à l’académie non seulement pour lui plaire, mais pour lui permettre d’y entrer. À cette idée, il se consolait de s’être encore laissé souffler un fauteuil. Il se disait même que, si Alexandre devenait son collègue, tous deux choisiraient la banquette, où ils seraient côte à côte.
Après la réunion, Georges se sépara de ses camarades, et longea l’étude des petits. Il s’arrêta un instant devant la fenêtre qu’il connaissait bien, et regarda l’enfant qui travaillait. Cette fois, il ne s’agissait pas de l’image d’un rêve, mais d’une réalité : celui qui était là, plus beau que tous, était son ami.
En attendant de faire un académicien, Georges décidait de se faire congréganiste : c’était moins difficile. Comment n’avait-il pas songé que le jeune Motier devait être un enfant de Marie, par égard envers le directeur ? Il avait fallu que Maurice le lui apprît. La séance de la congrégation suivait celle de l’académie. Quand Georges vit Lucien prêt à partir pour la chapelle :
« Tu sais, lui dit-il, je crois que, dimanche prochain, je t’emboîterai le pas. Lauzon recommence ses persécutions afin que je sois des vôtres, et je sens que mon prix d’instruction religieuse est en danger. »
Ne sachant à quoi employer cette dernière demi-heure d’étude, il prit son Virgile et prépara la traduction de demain. C’était le dénouement de l’épisode de Nisus et Euryale, qui ne l’avait jamais beaucoup captivé. Tout en traduisant, il se souvint des premiers vers, où il est question de la beauté du jeune Euryale, et les traits de l’enfant qu’il aimait vinrent éclairer le texte antique.
Le sort de ces deux héros unis par l’amitié, l’exalta. Rien ne lui parut plus merveilleux que de mourir comme Nisus sur la poitrine d’Euryale. Son émotion l’étonna. Il n’aurait jamais cru avoir envie de pleurer en traduisant du latin.
Au coucher, Georges avait dit que, fatigué par la promenade, il s’endormirait certainement avant que le surveillant fût parti. Il ne voulait pas terminer dans les bavardages ordinaires une aussi extraordinaire journée. Il lui tardait d’être seul avec lui-même, avec cet enfant qui était devenu soudain un autre lui-même. Tout cet après-midi, la vision enchantée avait été le fond du tableau. Dans le silence du dortoir, elle passait au premier plan et pouvait librement se contempler.
Georges revivait les minutes qui avaient été sa récompense. Il sentait encore le petit coude contre le sien, la petite main dans la sienne ; il lisait le regard, enfin si proche ; il connaissait enfin le son de la voix ; il se répétait les mots : « Il est gentil de te dire ça. » Surtout, il savait enfin un prénom où son esprit pût se complaire, et ce prénom semblait fait exprès pour rattacher l’enfant à son domaine et le lui amener du fond de sa vie, comme du fond de la légende.
C’était la digne conclusion de tant de miracles. Il y avait la monnaie d’Alexandre dans le médaillier de la maison, et elle en était la plus belle : elle avait inspiré le devoir de Georges sur la Grèce. Il y avait, dans l’Histoire de l’Antiquité, la phrase enchanteresse : « Alexandre, fils de Philippe, était célèbre par sa beauté… » Fils de Philippe ? Fils d’un docteur ? Alexandre était fils de Jupiter, l’oracle l’avait dit.
Georges ne regrettait pas que le prénom de l’enfant fût différent du sien, car il l’estimait plus beau. Il préférait même le nom de Motier à celui de Sarre ; mais il n’était pas fâché que Maurice eût fait entendre sa qualité. Cela l’aurait un peu relevé aux yeux de quelqu’un qui l’avait autrement ébloui et devant qui il s’était trouvé confus.
Ce soir, il venait annoncer au père Lauzon son intention, à présent bien mûrie, d’être congréganiste. Le bon père eut un sourire victorieux, et lui prit la main avec tendresse :
« Je me félicite pour vous de cette décision, dit-il : elle vous permettra de goûter un grand bonheur. Certes, j’estimais depuis longtemps que votre place était parmi nous, mais je ne pouvais que m’incliner devant vos raisons d’attendre, raisons respectables, quoique trop scrupuleuses, à mon gré. J’attendais donc, moi aussi, mais il n’était pas question de moi, et j’aurais été inquiet si la sainte Vierge avait attendu davantage. On ne peut être un bon élève ou le rester qu’en étant enfant de Marie. C’est, à la fois, le vrai couronnement de la piété et le meilleur moyen d’assurer les résultats du travail. Rappelez-vous ce pauvre Blajan qui, malgré sa ferveur, n’avait jamais consenti à entrer dans la congrégation. Eh bien, il est tombé malade et perd une année d’études.
« Je me garderai de porter un jugement téméraire en disant qu’il a été puni de cette provocation, mais j’admire la coïncidence. C’est comme cet autre fait qu’il vous est loisible de constater : par le temps le plus couvert, le soleil ne manque jamais de briller le samedi, ne fût-ce qu’un instant. Or, ce jour-là est consacré à la sainte Vierge, n’est-il pas vrai ? Là aussi, il serait puéril, voire imprudent, de conclure, puisque la cause est infiniment au-dessus de l’effet, mais c’est encore une coïncidence, et je me borne également à l’admirer. »
Georges demanda s’il pourrait assister à la réunion de dimanche prochain, à la chapelle.
« Puisque vous êtes si zélé, répondit le père, je prends sur moi de vous dispenser de la période d’observation : vous viendrez donc dès ce dimanche. Vous n’ignorez pas que l’on est reçu d’abord sans cérémonie, en qualité d’aspirant, et ensuite, à titre définitif et dans les formes, seulement au bout de trois mois. Je réduirai de même, en votre faveur, ce dernier délai. »
Il consulta le calendrier qui était sur la table.
« C’est aujourd’hui le 20 février. Par conséquent, les statuts reporteraient votre admission au dimanche 21 mai. Or, vous devez tenir à ce qu’elle ait lieu, je le devine, pour le mois consacré à Celle dont vous voulez être l’enfant. Je vous recevrai donc officiellement le dimanche 30 avril, à l’ouverture du mois de Marie. »
Il ajouta :
« Je ne doute pas, bien entendu, que vous n’ayez à cœur de ne pas décevoir tant de confiance. Songez que j’abrège votre épreuve de plus de quinze jours. Je ne l’ai jamais fait, et je vous prie de n’en rien dire, afin de ne pas créer de jalousies. »
Le père se leva et prit dans sa bibliothèque deux opuscules qu’il tendit à Georges.
« Ceci, dit-il, est le Manuel des enfants de Marie et se passe de commentaire ; et cela, un petit traité dont je suis l’auteur, et qui a remporté un prix, en 1911, à Rouen, devant l’Académie des Palinods. C’était sur ce sujet de concours : « La Très Sainte Vierge, considérée avant tout, mais non exclusivement, dans son Immaculée Conception. » Sans amour-propre de ma part, je suis sûr que l’académicien que vous êtes en fera doublement son profit. Vous savez d’ailleurs que la reine du ciel est également la reine de l’esprit. Déjà, chez ces anciens que vous aimez, Virgile avait prophétiquement parlé d’elle, dans l’églogue à Pollion… Jam redit et Virgo… »
Maintenant, le père compulsait des copies.
« Oui, dit-il, je voulais m’en assurer : votre dernier devoir de mathématiques est très bon. Au reste depuis janvier, vos progrès me frappent. Ne vous surprennent-ils pas un peu vous-même ? Pensez à ce que je vous ai dit. »
Georges était ravi : les choses se déroulaient à souhait, et les êtres devenaient ses instruments. Sa chance ne lui avait rien coûté, que d’attendre, comme le père Lauzon. Tout semblait le conduire désormais au même but caché.
Arrivé sur le palier, il vit Alexandre monter vers lui quatre à quatre. Cette rencontre, espérée en vain depuis tant de semaines, lui parut naturelle. Les sourires de la destinée ne l’étonnaient plus.
« Où cours-tu si vite ? dit-il à l’enfant.
— Chez le père Lauzon.
— Je viens justement de chez lui, mais, si je ne te dérange pas, je referai le chemin avec toi. »
Ils allèrent ensemble. Georges se disait : « Pourvu que nous ne tombions pas sur quelque professeur ! » Seuls les anciens élèves, dont les images tapissaient le couloir, les regardaient passer. Georges dit en les montrant : « Je suis fier qu’ils me voient aujourd’hui. » Il songeait à apprendre à l’enfant qu’il venait, à cause de lui, de se faire recevoir à la congrégation, mais il lui avait déjà fait un compliment au sujet des anciens élèves ; il ne fallait pas exagérer.
Lorsqu’ils furent près de la chambre du père, il tendit la main à Alexandre et lui dit au revoir. Puis, les yeux baissés, il ajouta doucement ce que tous deux savaient bien :
« Nous sommes amis, n’est-ce pas ?
— Oui », répondit l’enfant dans un murmure.
Revenu en étude, Georges se reprocha d’avoir été trop sentimental et de n’avoir pas été assez pratique. L’entrevue avait été aussi charmante que celle de dimanche, mais elle n’avait pas beaucoup avancé les affaires. Alexandre était venu une fois dans la cour de récréation, mais ne reviendrait peut-être jamais plus. Georges l’avait rencontré aujourd’hui, mais ne le rencontrerait peut-être jamais plus.
Il aurait dû profiter d’une telle occasion, en convenant d’un rendez-vous, ou au moins d’une correspondance. L’idée d’un rendez-vous l’effrayait un peu, mais l’autre lui parut intéressante : il enverrait un billet.
Il pensait à ces messages clandestins qui, en étude, circulaient de main en main jusqu’au destinataire. Il n’aurait voulu confier celui-là à personne, et ne voyait que la congrégation pour le remettre lui-même à Alexandre. Mais cela dépendrait de leurs places respectives, et qui plus est, dimanche était bien loin. En fait, leur seul rendez-vous certain restait la sainte table, aux dépens de Lucien. L’enfant, qui avait admis le coude à coude, admettrait-il aussi facilement le billet ? Le risque même enflamma Georges. Il allait voir de quelle étoffe était ce petit-là. Le moment était venu de briser la vitre, de franchir les dalles.
Toute la journée du lendemain, il rêva à ce que serait son message. Les devoirs lui parurent bien simples, en comparaison. D’abord écrirait-il « Alexandre », ou un diminutif, comme « Alex » ? Ne serait-il pas ridicule de l’appeler : « Mon cher petit » ou « Mon Bien-Aimé » ? Cela lui remit en mémoire la poésie du Bien-Aimé. Pendant l’étude du soir, il s’amusa, sur une page de son cahier de brouillon, à entremêler son nom avec celui d’Alexandre. Il tournait beaucoup de phrases dans son esprit.
Il s’était juré présomptueusement que ce serait pour le lendemain. Et le surlendemain encore, l’étude du soir allait finir, qu’il n’avait rien écrit. Bientôt le supérieur serait là, avec sa lecture spirituelle. Georges n’hésita plus ; il prit une feuille et traça machinalement :
Mon Bien-Aimé, je t’ai cherché
Depuis l’aurore… etc.
Il était assez honteux de se servir encore de ce poème, qui avait déjà servi pour Lucien, mais l’enfant n’était-il pas le vrai Bien-Aimé ? Lucien ne l’avait jamais été sérieusement. Il était, par rapport à Alexandre, ce que Lucius Vérus était par rapport à l’autre Alexandre.
Georges signa de son nom. Il ne l’avait pas fait dans le carnet de Lucien, plutôt par respect des Lettres que par toute autre considération. Maintenant, cette signature lui semblait un acte de courage qui rachetait la supercherie. Nul doute qu’en cas de surprise, cela ne le fît mettre à la porte, même si Edmond Rostand était plus connu du supérieur que le baron de Fersen. Tant pis : il jouait son va-tout.
Avant la communion, il avait montré à l’enfant, entre ses doigts croisés, le billet qu’il lui destinait, et Alexandre n’avait marqué aucun étonnement. Georges lui glissa le message après avoir pris la place de leur voisin.
Il appréhendait une observation de Lucien sur ces tours de passe-passe qui se répétaient un peu trop souvent, mais celui-ci semblait affecter de ne pas y prendre garde. Georges souhaitait néanmoins que l’enfant eût la prudence de laisser écouler quelques jours avant de lui répondre. Il se félicita d’avoir été deviné.
Mais le dimanche matin, dès l’arrivée à la chapelle, Alexandre sourit d’un air prometteur et, peu après, posa un instant, sur sa cravate rouge, un carré de papier blanc. Tout alla fort bien.
Georges aurait ouvert le billet dans son missel, s’il n’avait craint d’être aperçu du sieur Rouvère. Aussitôt en étude, il prit le plus gros de ses livres — son Virgile — et, à l’intérieur, déplia discrètement le petit feuillet. L’écriture était fine et minutieuse. Une guirlande de fleurs joliment dessinées entourait ce texte :
Georges,
Merci pour vos vers charmants.
Je pense à vous tout le temps.
Je travaille bien pour ne pas redoubler la cinquième.
Ainsi nous serions ensemble l’année prochaine.
Ce serait très beau, puisque vous m’aimez
Et que je vous aime.
Après la signature, on voyait ce post-scriptum : Ne rien dire à Maurice. Puis, cette parenthèse : (Il y a une rime qui ne rime pas.)
Georges contempla une dernière fois le dessin, les plis du papier, l’encre bleue. Comme s’il soufflait un grain de poussière, il s’inclina et baisa le billet. L’ayant replié avec soin, il le mit dans son portefeuille, face à face avec l’image de l’Amour de Thespies.
Suivant l’usage, il écrivit ensuite à ses parents. Il ne se souvenait pas de leur avoir jamais adressé une lettre aussi affectueuse. Alors qu’il commençait d’habitude : « Cher papa et chère maman », il écrivit : « Bien cher petit papa et bien chère petite maman. » Il y eut des phrases poétiques sur les premiers rayons de soleil qui éclairaient l’étude, et sur le chant d’un coq que l’on entendait au loin. Il parla aussi, comme d’un triomphe assuré, de la composition de mathématiques faite cette semaine et dont les résultats seraient publiés aujourd’hui. Pourtant, il s’attendait que sa place fût des plus mauvaises, puisqu’il avait été réduit à ses propres forces — il se demandait même si le père Lauzon ne le soupçonnerait pas d’avoir déplu à la Sainte Vierge. Enfin, dépassant la mesure ordinaire, il envoya « un million de baisers ».
Sans le savoir, il ne s’était pas trompé au sujet de la composition : il fut tout étonné, à midi, de s’entendre nommer le huitième. Peut-être le père Lauzon avait-il tenu à lui confirmer que l’on faisait mieux ses problèmes en devenant congréganiste. Dans ce cas, c’est une place que Georges devait à Alexandre, puisque c’est pour lui qu’il était entré à la congrégation. D’ailleurs, il était heureux de lui céder le pas aujourd’hui : l’enfant était cinquième.
À l’académie, Georges put avoir un fauteuil, mais n’en trouva pas moins la séance d’une longueur désespérante. Il donnait au diable tout le programme : et le sonnet du supérieur, et la conversion de Pascal, et le grand-maître du collège de Navarre. Il ne songeait qu’à une chose : l’heure de la congrégation. Il justifiait à merveille son titre d’aspirant.
Peu après le retour en étude, le père Lauzon était apparu sur le seuil de la porte : c’était le signal du départ pour les enfants de Marie.
Les yeux d’Alexandre s’éclairèrent d’une heureuse surprise. Mais Georges avait bien fait de ne pas compter échanger des billets à cette réunion. Les congréganistes patentés étaient à gauche de la nef, et les autres à droite. Pendant l’homélie, Georges, en se penchant, apercevait à la dérobée la silhouette d’Alexandre.
Le soir, Lucien lui dit :
« Ne t’endors pas trop vite, tout à l’heure, même si tu es fatigué par la promenade. »
Il avait eu un air malin, et Georges comprit tout de suite que son secret était découvert : il allait être question d’Alexandre. Sans doute Lucien n’avait-il pas osé aborder en plein jour ce sujet délicat. Il se sentait plus hardi pour procéder à son interrogatoire dans la pénombre, à voix basse. Georges avait cessé d’être seul ici avec l’enfant.
« Tu me fais de la peine, dit Lucien ; tu te défies de moi, comme si j’étais, non pas ton ami, mais un faux frère. Crois-tu que je n’aie pas vu que tu lisais un billet ce matin ? Il ne m’a pas été difficile, alors, de deviner le pourquoi de certains changements de place à la communion, de ton entrée à la congrégation et de quelques sourires interceptés. Non seulement tu m’as dissimulé un tas de choses, mais, par-dessus le marché, tu t’es fichu de moi avec ta Variation brillante. Ce n’est pas chic. »
Georges avait été touché par le ton avec lequel Lucien venait de lui parler. Il craignait de vifs reproches, passablement justifiés, ou des railleries mordantes, qu’il aurait eu peine à souffrir.
« Oui, mon cher Lucien, dit-il, nous sommes et nous serons toujours amis. Si je t’ai fait une grande cachotterie, ce n’est nullement par défiance, je te jure ; c’est par goût, par plaisir, un peu aussi par pudeur. Et puis, je craignais de te fâcher en te montrant que je cherchais une amitié en dehors de la tienne.
— Mais je ne t’en veux pas ! Au contraire, je suis enchanté, puisque ça te calme. »
Georges rit de ce mot, et Lucien continua :
« Tu sais bien, d’ailleurs, que j’ai également un autre ami. J’avais toujours admiré de quelle façon André s’y était pris avec moi à propos d’engelures, mais j’admire encore davantage ton audace de t’être attaqué à un garçon de l’autre division. Sans rien dire, j’observais ton manège, qui m’amusait beaucoup. Chacun son tour d’observer, mon vieux : te rappelles-tu tes remarques du début, au sujet d’André et de moi ? Mais, dis-moi, quel est le prénom du petit Motier ? »
En le prononçant, Georges éprouva un plaisir délicieux, et à mesure qu’il racontait toute l’histoire — sauf la réédition du « Bien-Aimé » — il regrettait les joies dont l’avait privé sa discrétion. Il se demanda un instant si le fait d’en parler avec Lucien n’y était pas pour quelque chose. Eh ! qu’importe ! des souvenirs étrangers pouvaient s’ajouter aux impressions d’à présent : ils n’empêchaient pas celles-ci de demeurer incomparables.
Lucien fit remarquer qu’Alexandre et André avaient la même initiale et qu’étymologiquement, ces deux prénoms se ressemblaient. Il offrit de faire passer les billets, à l’occasion.
« Si tu es poète, dit-il, tu auras de quoi t’exercer. Avec le nom d’Alexandre, on a l’Olympe entier à son service. Ce n’est plus comme avec moi, pour qui l’on se contente de copier Rostand.
— Tu aimes mieux que l’on copie Fersen », dit Georges.
Lucien se contenta de sourire. Il souhaita connaître la date, l’heure et le lieu de naissance d’Alexandre, en vue de faire dresser son horoscope aux prochaines vacances. Le thème de Georges serait également établi, et l’on verrait si les constellations les inscrivaient tous deux au nombre des amis célèbres, comme André et Lucien.
La séance solennelle de l’académie se tenait à la mi-carême. Cela paraissait à Georges assez impertinent envers une compagnie vouée principalement à la lecture d’oraisons funèbres et au culte du grand siècle. Mais il n’en avait pas moins accepté avec joie d’être un des orateurs de la journée — le 28 de ce mois de mars qui venait de commencer. Ce serait une nouvelle occasion pour lui de briller devant Alexandre. Mais aussi, de quel sujet ne l’avait-on pas affublé : « L’Hôtel de Rambouillet » ! La guirlande dessinée par Alexandre disait plus à son cœur que la guirlande de Julie.
En parcourant un ouvrage utile à son travail, il vit une photographie de la carte du Tendre. À défaut de la carte du ciel proposée par Lucien, il voulut confronter sa tendresse avec cette autre. Mlle de Scudéry serait-elle auprès de la tendresse une introduction que son frère n’était pas auprès de la littérature ? Les initiales de ce dernier, qui l’avaient fait inscrire sur la liste de Georges, ne signifiaient pas plus à cet égard que, dans les annales de l’amitié, celles d’André et d’Alexandre. Sans nul doute, Alexandre aurait éclipsé Polexandre à l’hôtel de Rambouillet. Il aurait été charmant, avec les habits d’un jeune seigneur de cette époque. Il était de tous les siècles.
La carte du Tendre ne se lisait pas facilement. Il fallait de bons yeux pour se diriger dans ce pays. Georges retrouvait là des étapes dont les noms figuraient déjà dans son itinéraire ou s’y inscrivaient d’avance : « Jolis Vers », « Billets Galants » et « Billets Doux », « Sincérité », « Grand Cœur », « Probité », « Assiduité », « Petits Soins », « Grands Services », « Sensibilité » et « Constante Amitié ».
Il pouvait revendiquer également le droit de cité dans chaque ville de « Tendre » : « Tendre-sur-Estime », « Tendre-sur-Reconnaissance » et « Tendre-sur-Inclination ». L’inclination l’avait porté vers Alexandre, l’estime avait attaché Alexandre à lui, et leur reconnaissance était réciproque, maintenant que leur tendresse l’était aussi.
Certaines places ne se rencontreraient jamais sur leur route : « Négligence », « Inégalité », « Légèreté », « Oubli », « Indifférence », « Indiscrétion », « Perfidie », « Méchanceté », « Inimitié ».
Bref, tout cela était assez fade. Il est vrai que deux autres noms étaient là pour réveiller l’imagination : « Mer Dangereuse » et « Terres Inconnues. »
Georges et Lucien ne parlaient jamais d’Alexandre dans la journée. Ce sujet était réservé à leurs entretiens nocturnes, comme la première fois où ils l’avaient abordé. Invisible, l’enfant s’asseyait entre eux sur la petite table. L’heure et le lieu lui conféraient une nouvelle séduction.
Georges, à présent, aurait souhaité qu’il ne fût plus question d’Alexandre, mais Lucien mêlait toujours à ces images celles d’André. Tour à tour, ils prônaient leurs héros, à la façon des bergers dans les chants alternés des églogues. Mais leur lyrisme était différent. Celui de Georges ne pouvait être que fort honnête et peu copieux. Lucien, à l’inverse, rassuré maintenant du côté de son voisin, se montrait plus libre encore que dans leurs premières conversations. Et Georges était gêné par ces confidences que, dernièrement, il avait voulu provoquer. Cette place où il évoquait Alexandre avait été celle d’André, l’année dernière. L’amitié dont on lui donnait les détails avec cynisme lui apprenait ce que n’était pas la sienne. Le plus souvent, il regrettait que chacun n’eût pas gardé ses propres secrets, mais parfois il enviait ceux de Lucien. Il fallait Lucien pour l’intéresser à de tels secrets. Lorsque le hasard les lui avait fait surprendre ici dans d’autres amitiés, ils ne lui avaient inspiré que du dégoût. Mais, certains jours, ce dégoût même lui paraissait un leurre. Tantôt il était épris d’idéal et de pureté, tantôt il se sentait attiré par les exemples contraires. Il se rappelait les expressions du Cantique des Cantiques : « Le jardin fermé…, la fontaine scellée. » N’était-il pas le maître de cueillir tous les fruits du jardin, et, s’il lui plaisait, de troubler l’eau limpide ?
Pendant une récréation, sous prétexte d’aller au piano, il se glissa vers la cour des petits.
Il s’arrêta à l’extrémité du couloir qui débouchait sur cette cour. Il attendit un moment, espérant qu’il apercevrait Alexandre et pourrait l’appeler. Mais l’enfant ne se montra pas, et Georges n’osa s’aventurer plus loin.
Quand il fut parti, il se trouva tout bête, comme le jour de leur rencontre dans le couloir. Cherchant à s’expliquer son manque de résolution, il se demanda si c’était la peur du surveillant qui l’avait retenu.
Il conclut qu’il ne s’inquiétait de personne, et que celui qu’il aimait devait suffire à lui faire braver n’importe quoi. C’était donc celui-là seul qui l’intimidait. Georges crut découvrir l’origine de la fausse honte dans le sentiment de l’avoir dupé par son billet. Il devait, avant de l’approcher, lui adresser autre chose qu’un texte d’emprunt.
À l’étude du soir, il écrivit — cette fois, d’une traite — les lignes suivantes, qu’il lui remettrait demain, pendant la communion :
Cher Alexandre,
Je vis, depuis dimanche, dans la douceur de ton billet. Il est toujours sur mon cœur et me rend ta présence plus complète. Le collège, c’est en effet ta présence. Ses heures ne sont réglées que pour me la donner. Tu descends du dortoir vers moi, comme l’image du matin. Midi me nourrit de toi et, le soir, tu ne parais t’éloigner que pour mieux me rejoindre. Le savais-tu ?
Au petit déjeuner, Alexandre lui sourit. Georges fut content de ce sourire.
Lucien, à la sainte table, s’effaçait maintenant avec discrétion, si besoin était. Aujourd’hui, Alexandre avait fait signe qu’il avait un billet à remettre, et ce fut à la chapelle même que Georges en prit connaissance. Il n’y avait que ces trois mots, écrits en grosses lettres : Je suis heureux.
Georges aussi fut heureux. Mais quand Lucien lui demanda le billet, il ne s’en dessaisit pas. Il s’était dérobé déjà à propos du premier.
« Ce ne sont que des bêtises, dit-il, et qui comptent pour moi seul. »
Pour lui, ne comptaient plus que ces bêtises. Quelquefois, au cours de la journée, il se répétait les deux messages d’Alexandre, afin d’en goûter la saveur. Au milieu de l’étude ou de la classe, ils étaient pareils, tout à coup, à ces rayons de soleil et à ce chant du coq qu’il avait décrits à ses parents.
Le soir, dans son lit, il en ressentait au contraire moins d’exaltation que d’apaisement. Ces paroles n’étaient plus des traits de lumière, un hymne de victoire. Elles étaient murmurées à son oreille et devenaient insensiblement celles de son rêve. Elles étaient la petite veilleuse de son âme endormie, comme celle dont la clarté baignait le dortoir.
Georges attendait vendredi pour tenter une nouvelle démarche chez les petits, pendant la récréation d’une heure. Il espérait qu’en l’honneur de ce jour, Vénus lui accorderait sa protection. C’était un vendredi de février qu’il s’était signalé à Alexandre par son premier coudoiement. N’avait-il pas raison de croire un peu aux divinités de la fable ?
Il alla d’abord au dortoir se parfumer abondamment les cheveux. Il se trouva plus frais, plus intrépide.
En arrivant au bout du couloir où, l’autre jour, il avait hésité, il vit Alexandre juste en face de lui, adossé à un arbre. Ramassant un petit caillou, il le jeta sur l’enfant. Celui-ci regarda dans sa direction et parut tout joyeux. Mais ce fut avec une lenteur majestueuse qu’il s’avança vers Georges, comme pour l’honorer.
« Je viens bavarder avec toi, si ce n’est pas trop imprudent », dit Georges.
L’enfant, d’un geste dédaigneux, montra au loin le surveillant qui jouait au ballon avec des élèves, en tenant le bas de sa soutane ramassé dans une main.
« Allons sous les arbres, dit-il ; nous y serons très bien. »
Ils s’assirent sur le petit mur qui bordait la cour. Georges était étonné de ne pas éveiller l’attention. Les choses étaient toujours plus simples qu’il ne croyait.
« Si le surveillant nous demande des explications, dit-il néanmoins par manière d’acquit, nous répondrons que je suis venu pour une affaire de la congrégation.
— Inventons autre chose, dit Alexandre en riant. J’aime mieux ne pas mêler le père Lauzon à nos affaires.
— Il est vrai qu’il ne s’en est déjà mêlé que trop. Je l’ai détesté au mois de janvier, quand il te gardait chaque matin dans la tribune.
— Oh ! c’est qu’il prétend m’aimer comme son fils. Je vais me chauffer chez lui, quand j’ai froid en récréation, et il me donne de la tisane avec du miel. Je suis son pénitent. Et vous ?
— Naturellement, mais il me traite sans tisane. À propos, je veux te prier tout de suite de me tutoyer ; c’est plus gentil.
— Bon ! te souviens-tu des vers qui ne rimaient pas, dans mon premier billet :
… Puisque vous m’aimez
Et que je vous aime ?
« Il aurait fallu :
… Puisque tu m’aimes
Et que je t’aime.
« Mais je n’osais pas tutoyer un grand poète, un académicien.
— C’est toi qui es le plus grand poète de nous deux, et il te manque seulement d’être académicien. As-tu les notes de français qui permettent d’être candidat ? En tout cas, voilà pour le surveillant, s’il vient à nous : je suis un émissaire de l’académie. »
L’enfant cherchait dans sa mémoire : il ne voyait que deux copies à présenter : « Les semailles », devoir du trimestre précédent, et la composition qui lui avait valu la seconde place : « La mort d’Hector ».
Georges s’offrit à l’aider, en vue de hâter la réunion des conditions académiques : sur les sujets que communiquerait Alexandre, il ferait rapidement un plan ou un brouillon. Mais l’enfant, après l’avoir remercié, répondit qu’il ne copiait jamais.
« Pourtant, ajouta-t-il, je ne suis pas bien fort, puisqu’il y a, dans tes vers, des choses que je n’ai pas comprises. Qu’est-ce que signifie, par exemple :
Ton nom répand toutes les huiles principales ?
— C’est du style biblique, dit Georges, ou du pastiche de ce style, de même que les expressions : parfums essentiels, etc. On trouve cette phrase au début du Cantique des Cantiques (excuse-moi de faire le pédant) : « À cause de ces excellents parfums, le nom de mon Bien-Aimé est une huile répandue. »
L’enfant se mit à rire :
« Ta poésie sent l’huile, dirait notre professeur. Mais toi, tu sens le parfum. J’aime d’ailleurs ce parfum-là. Je l’avais remarqué un jour, à la table de communion.
— C’est de la lavande », dit Georges.
Dans la trame qu’il avait patiemment tissée, rien n’avait été perdu. D’autre part, la raillerie touchant le poème l’avait enchanté. Il lui semblait expier ainsi sa mystification. Et néanmoins, cette mystification lui était chère : Alexandre n’avait pas supposé un instant, comme Lucien, ni que ces vers ne fussent pas de lui, ni qu’ils eussent été placés dans la bouche d’une femme.
« Je te sais par cœur, dit l’enfant. Je me répète tes strophes avant de m’endormir, mais ce n’est pas pour m’endormir ; et aussi à la chapelle, quand je te regarde. Bien mieux : l’autre jour, en classe de français, nous avions une récitation de Victor Hugo : Mon père, ce héros… Je fus interrogé le premier, alors que justement je pensais à toi, et, au lieu de dire : « Mon père… », je dis : « Mon Bien-Aimé… » Tu devines le chahut. Je me suis excusé en disant que j’étais en train de songer à une prière dont c’étaient les premiers mots. Et n’est-ce pas la vérité ? car je ne pourrai jamais mentir complètement. »
Il s’arrêta, puis il dit en souriant :
« Si j’avais su que tu viendrais, j’aurais mis ma cravate rouge. Je l’ai achetée à un camarade, afin d’avoir la même que toi.
— Attention ! dit Georges. C’est la couleur du feu. Ne crains-tu pas de te brûler ? »
Depuis un moment, il caressait du bout des doigts la main de l’enfant, appuyée près de lui sur la muraille, et cette main venait de saisir tendrement la sienne et la serrait peu à peu de toute sa force.
Au dortoir, Georges raconta à Lucien l’heureuse visite de cet après-midi. Dans les récits relatifs à Alexandre, il y avait constamment des omissions : cette fois, ce fut, non seulement le commentaire des stances, mais aussi le serrement de main. Georges ne voulait pas rappeler à Lucien ce geste qu’il avait eu avec lui pendant une conférence de la retraite.
« Avez-vous pris rendez-vous ? demanda celui-ci.
— Non, mais il sera possible de retourner là-bas ; le surveillant ne m’a pas aperçu.
— Drôles d’amis que vous êtes ! Si l’on s’aime vraiment, on désire se rencontrer ailleurs qu’en pleine récréation. Je te signale un bon endroit pour des rencontres plus intéressantes : la serre qui est sur la terrasse, au-dessus de la grotte du grand saint Claude. Ce n’est pas connu. André et moi, nous y avons été bien souvent. »
Ainsi, Georges se trouvait devant la perspective de son premier rendez-vous — il savait maintenant en effet qu’il suivrait le conseil de Lucien. Cette éventualité, qu’il avait d’abord écartée, lui apparaissait déjà toute proche. Il voyait cette serre qu’il ne connaissait que du dehors. Blajan la lui avait indiquée, sans se douter qu’elle abriterait l’amitié de son interlocuteur, ni qu’elle eût abrité celle de Lucien. Georges se demandait à quoi l’y destinaient ces derniers auspices. Les récents propos de Lucien lui revenaient, accompagnés de leurs images précises. Mais cela ne l’empêchait pas d’avoir sommeil. Le marchand de sable passait sur ces idées, comme sur celles qu’il avait à pareille heure, il y avait deux ou trois ans.
Pour juger du contraste avec aujourd’hui, il se divertit à chercher ce qui constituait alors ses préoccupations puériles, et cet effort le tint éveillé encore quelques instants : il s’était fait griffer par le chat : un tel avait triché aux billes ; le roman d’Indiens était passionnant ; l’entremets avait été manqué ; la femme de chambre était bête — est-ce que, demain matin, en apportant le petit déjeuner, elle oublierait encore le sucre ?
Ces souvenirs l’attendrissaient et l’inquiétaient aussi. Il était toujours un enfant, et il vivait déjà dans le sacrilège, dans l’imposture, dans les amitiés défendues.
Georges n’avait jamais été si impatient de la grand-messe que ce premier dimanche de carême.
Le carême ne le touchait pas plus que la Sexagésime ne l’avait touché. Mais, à la messe basse de ce matin, il avait reçu ce billet d’Alexandre :
Tout à l’heure, je serai thuriféraire. Quand j’encenserai du côté des grands, ce sera pour toi.
L’enfant, qui venait d’arriver dans le chœur parmi les autres acolytes, paraissait tranquille, sûr de lui, fort de son secret.
Il n’avait pas rempli ces fonctions cérémoniales depuis la rentrée de janvier. Georges le comparait à ceux qui servaient avec lui et qui avaient l’air de le servir. Le supérieur même, qui officiait, n’était auprès de lui qu’un pauvre diable de prêtre, dont le gouvernement de ce collège représentait le bâton épiscopal. Alexandre, pour peu qu’il le voulût, deviendrait pape. Dans les siècles passés, il aurait été cardinal à quinze ans, comme l’un des bienheureux que le prédicateur avait cités.
Georges se rappelait le jour où il avait vu Lucien tenir, auprès d’André, l’encensoir que tenait Alexandre. À ce moment-là, il avait été scandalisé, et ne l’était pas à présent le moins du monde. Il s’était beaucoup formé. C’était son tour de triompher avec impudence. Toutefois, il avait prié Lucien de ne pas regarder pendant l’encensement : il souhaitait en bénéficier seul.
Alexandre avait encensé le supérieur, puis la nef et les petits. Il se tourna du côté des grands, et, fixant Georges droit dans les yeux, comme s’il n’y avait personne d’autre ou que son ami fût le jeune seigneur de Saint-Claude, il balança l’encensoir vers lui, les trois fois rituelles. Son visage n’avait pas changé, mais Georges était heureux que personne n’eût observé le sien : il était bouleversé. Néanmoins, il savait gré à Alexandre d’avoir été si hardi, et se décidait à l’être : demain matin, il lui donnerait rendez-vous dans la serre, pour le soir, à six heures.
En traversant la cour de récréation, Georges longea la muraille afin de ne pas être vu du premier étage. Il gagna le sentier, et arriva sans encombre à la serre. Lucien avait raison ; c’était une excellente cachette. Des caisses d’orangers faisaient autant d’écrans, à l’intérieur de la verrière, et l’échafaudage en gradins qui supportait les vases étant ouvert d’un côté, les dessous offraient un abri accessible, en cas de péril.
Georges se mit aux aguets près de la porte. Il doutait que ce qu’il souhaitait tant fût possible. Au réfectoire, Alexandre avait bien fait un signe d’acquiescement, mais on lui refuserait peut-être la permission de s’absenter ; peut-être qu’il était puni. S’il venait, suivrait-il l’allée, où l’on risquait de l’apercevoir ? Connaissait-il le sentier, qui était plus discret, mais l’obligerait à un détour ?
Soudain, Georges, le cœur battant, entendit un pas dans cette direction. Et l’enfant apparut, aérien, gracieux, comme s’il s’était posé par enchantement au bord de la terrasse. Il était toujours aussi naturel, aussi calme. Il semblait accomplir une démarche fort simple.
Pourtant, à peine entré, il grimpa au haut des gradins, semblant hésiter encore à se laisser approcher. Il devait bien avoir conscience que cette réunion était quelque chose de plus dans leur amitié.
Georges le suivit, entre les vases, et s’assit à la marche au-dessous, près de ses jambes nues. Il n’imaginait pas de pouvoir lui dire quoi que ce fût ; les paroles auraient détruit un charme. Il regardait ces genoux qu’étoilaient des cicatrices, souvenirs de cette existence de jeune garçon qui prenait une autre tournure aujourd’hui.
Il appuya la tête sur ces beaux genoux. Il aurait voulu dormir ainsi, mourir ainsi. Toute sa vie n’avait été faite que pour cet instant. Puis il se haussa un peu jusqu’à la poitrine. Quelle surprise ! Ce calme admirable n’était qu’extérieur : le petit cœur battait à grands coups, comme celui de son ami. Il fallait répondre à cet appel charmant : Georges se releva et vint se placer à côté d’Alexandre, joue contre joue. Il s’imprégna de ce visage, s’écarta afin de mieux le contempler. Il le trouvait si merveilleux qu’il n’osait lui donner un baiser.
Voyant au cou de l’enfant une chaînette d’or, il la retira et contempla la médaille qui s’y trouvait suspendue. Elles étaient tiédies l’une et l’autre par sa chaleur secrète, et, comme pour y ajouter sa propre chaleur et ses propres secrets, Georges les baisa longuement.
Quand il fut de retour, il reconnut à peine la salle d’étude. Cependant, rien n’avait changé : le surveillant lisait sa revue pieuse ; il y avait, dans le coin, le même élève puni. Georges répondit par un sourire au regard de Lucien qui l’interrogeait. Dans le compte rendu nocturne, il ne dit mot de son chaste baiser. Quand il eut terminé, Lucien lui demanda s’il n’avait pas embrassé Alexandre. Ce diable de garçon devinait les choses. Il avait passé par là.
« Non, pas de baiser, répondit Georges. Ce n’est pas obligatoire, je suppose ?
— Tu verras bien ! On commence par le sentiment, et l’on en vient peu à peu aux sensations. Bourdaloue a dit quelque chose dans ce goût-là, et je me rappelle qu’André me pressa du pied lorsque le prédicateur en avait parlé, à la première conférence. »
Georges fut troublé par l’idée qu’Alexandre pût être déjà tel que Lucien. Il s’était dit que son innocence n’était probablement que relative, mais il n’aurait pas voulu le savoir pervers. Il souhaitait que leur amitié restât à égale distance du bien et du mal. Mais quelle était la cause des élans que cet enfant avait pour lui ? Était-il un de ces anges qui sont des démons ? Il s’était prêté bien facilement au tête-à-tête. Il avait insisté afin que le prochain rendez-vous eût lieu dès après-demain, malgré le souci qu’avait Georges de se montrer plus prudent. Son impatience n’était-elle pas un calcul de sa précocité ? Digne frère de Maurice, faisait-il son credo des tristes vers de Richepin ?
Sans doute, tout récemment encore, il semblait très attentif aux actes religieux ; mais on savait ce que signifiaient les apparences, à Saint-Claude. Pendant qu’il servait la messe dans la tribune avant d’avoir connu Georges, il songeait peut-être à autre chose que la messe. Si sa piété avait été bien réelle, aurait-il accepté ensuite un équivoque voisinage à la communion ?
Il était, en somme, comme le Lucien du premier trimestre, qui était chef de série de la Sainte-Enfance, et n’avait pas, pour cela, cessé d’aimer André. Qui sait s’il n’avait pas une amitié particulière dans sa propre division ?
Cette question préoccupa Georges jusqu’au rendez-vous suivant.
« As-tu un grand ami chez tes camarades ? » demanda-t-il à Alexandre, quand ils furent réunis de nouveau dans la serre.
L’enfant, étonné, répondit que non.
« Moi non plus, évidemment. Je n’ai de grand ami que toi, mais je suis très lié avec mon voisin, Lucien Rouvère, celui qui est à ma gauche à la chapelle. Cela me donne le plaisir de parler de toi. »
Alexandre parut frappé de stupeur :
« Comment ! tu parles de moi ?
— Lucien est un ami.
— Tu as donc deux amis ! Moi, je ne puis en avoir qu’un. »
Ayant dit, il partit en courant.
Georges resta sur place, hésitant à croire à ce qui venait de se passer. Il était désespéré comme il ne l’avait jamais été. Son bonheur lui avait échappé, et c’était par sa faute. Il n’avait parlé d’amitiés étrangères que pour éprouver Alexandre, et l’épreuve s’était retournée contre lui. Il s’était imaginé que cet enfant était hypocrite, et il avait la preuve superflue de sa loyauté. Il n’avait pas très bien lu la carte du Tendre : parmi les lieux à éviter, il y avait « Légèreté ». Pourtant, à mesure qu’il se rapprochait de l’étude, il cherchait à se persuader que le fruit de tant de peines ne pouvait être perdu. Il retrouvait, dans les derniers souvenirs qu’il y avait rapportés, une raison d’avoir confiance. D’ailleurs, par une réaction aussi vive, l’enfant ne lui avait-il pas montré qu’il l’aimait ?
Lucien également le rassura. Il ne jugeait pas possible que l’on se fâchât sérieusement pour si peu : toutes les amitiés, tous les amours ont leurs confidents, témoin le théâtre classique. Il irait s’expliquer lui-même avec l’enfant. Il lui apprendrait qu’il avait aussi un vrai ami, dont il était séparé, mais que personne ne pouvait remplacer. Georges déclina ces bons offices : il ne se repentait que trop d’avoir mis Lucien entre Alexandre et lui.
À la messe du lendemain, l’enfant n’était pas moins pimpant qu’à l’ordinaire, peut-être encore mieux peigné, mais pas une fois il ne leva les yeux vers Georges. S’il n’avait tourné les pages un peu bien vite, on aurait pu supposer qu’il lisait son livre. À la communion il fit exprès de s’attarder, de manière que ni Georges ni Lucien ne pussent être auprès de lui. Et son attitude resta la même les jours qui suivirent.
Triste dimanche que celui-ci ! Georges, durant la grand-messe, pensait à celle de dimanche dernier, où cet enfant, qui fuyait aujourd’hui ses regards, l’avait alors encensé. Au réfectoire, il entendit le nom qui naguère le ravissait de sa grâce, et qui aujourd’hui lui perçait le cœur.
Il eut une courte joie à vêpres : Alexandre arborait à présent sa cravate rouge, qu’il n’avait pas mise le matin — il avait dû opérer ce changement pendant la récréation d’une heure. Mais c’était sans doute simple fantaisie : ce n’était même pas une attention ironique, car il ne manifesta pas plus d’intérêt pour celui en l’honneur de qui il avait acheté cette cravate.
La semaine s’écoula aussi morne. Un matin, afin de tenter d’émouvoir par son absence, Georges resta couché. Il remarqua, au repas de midi, que l’enfant lançait un coup d’œil vers sa place. Cela lui parut bon signe : on continuait à l’observer à la dérobée. Mais, avant de hasarder une démarche personnelle, il voulait qu’Alexandre fût détrompé à l’égard de Lucien. Il révoqua sa décision du premier soir et fit appel à l’auteur innocent de leur brouille.
Lucien, reprenant un des rôles auxquels il avait renoncé depuis la rentrée, alla dans la cour de l’autre division pour les affaires du Rosaire Vivant. Il réussit à aborder Alexandre sans témoin, et lui dit qu’il avait à lui parler, mais l’enfant s’était déjà éclipsé. Lucien revint à la charge, le lendemain, avec le bulletin de la Sainte Enfance. Afin d’amorcer la conversation, il recommanda l’article : « L’âme des petits Malgaches », et dut se contenter de la réponse que son interlocuteur s’intéressait uniquement aux petits Chinois.
En classe de latin, on traduisait maintenant les Bucoliques ; aujourd’hui, c’était le tour de la deuxième églogue intitulée Alexis. Une note disait que cet Alexis était un jeune esclave donné au poète et qui s’appelait Alexandre.
Le Tatou commença la lecture sur un ton persifleur ; les élèves souriaient aux passages les plus tendres.
Georges n’avait pas oublié l’émotion qu’il avait ressentie au récit de la mort de Nisus et Euryale, après sa première rencontre avec l’enfant. De nouveau, il se retrouvait lui-même dans l’œuvre de Virgile : l’attachement du poète, les cruautés d’Alexis, c’était sa propre histoire.
Pendant l’étude, il traduisit les derniers vers en vue de savoir comment cela se terminait. Il fut extrêmement choqué par le conseil de choisir un autre Alexis. Il ne se sentait pas du tout un cœur de Romain.
La nuit le rapprochait de l’enfant. Il s’enfonçait sous les draps et relisait, à la clarté de sa lampe électrique, les deux billets qu’il n’eût donnés pour rien au monde. Il les chérissait, non seulement dans leurs paroles, en vérité peu nombreuses, mais aussi dans leur présentation et dans les détails de leur écriture. Il croyait voir réapparaître entre leurs lignes, derrière leurs mots, le visage qui s’y était penché, la main qui les avait écrits. Il espérait que cette liturgie nocturne aurait le pouvoir d’une incantation. Un dieu y présidait, l’Amour de Thespies. Son image, compagne des billets, démentait que tout ne fût que poussière et proclamait qu’il fallait croire à la vie. L’amitié de Georges et d’Alexandre serait sauvée par sa beauté, comme l’avait été la statue.
Un après-midi, Georges, consultant par hasard son calendrier, vit, dans une sorte d’éblouissement, que ce jour même, samedi 18 mars, était la Saint-Alexandre. Sans cela, l’aurait-il su ? À la méditation, le supérieur avait annoncé saint Cyrille, évêque et confesseur. De même que pour la Saint-Lucien, le martyrologe ne correspondait pas au calendrier profane, et saint Alexandre ne s’y inscrivait que le 3 mai. Georges voulut voir dans cette heureuse découverte la promesse du pardon : le saint, après le dieu, se déclarait en sa faveur.
On allait faire tenir un billet à l’enfant, par une voie qui était libre : le message serait déposé dans son tiroir au réfectoire. Après deux ou trois brouillons — la plume était redevenue moins facile — Georges transcrivit :
Alexandre,
Je te présente mes vœux de bonne fête, accompagnés d’un cadeau, dont tu excuseras la modestie. Permets-moi de te redire que je t’aime et de te jurer que je n’aime et n’aimerai que toi. Tu es devenu ma vie.
Le modeste présent était un flacon de lavande que Georges venait de recevoir. Après sa première visite à Alexandre, il avait demandé ce flacon à ses parents pour le lui offrir, puisque le parfum lui avait plu. Cet envoi était arrivé à point nommé.
Le réfectoire était désert. Georges se rendit à la place d’Alexandre et ouvrit le tiroir. Il vit les initiales gravées sur sa timbale : « A. M. », comme les premières lettres d’Amitié ou d’Amour. Il déposa, sous la serviette, le flacon et le billet. Il était ému d’avoir touché ces objets, ce tiroir.
Au dîner, Georges regarda : l’enfant parut étonné, puis il avait mis le billet dans sa poche ; avant le départ, il y glissa également le flacon. Bien qu’il ne se fût pas retourné vers Georges, celui-ci avait le sentiment que la cause était gagnée.
Le lendemain, en arrivant à la chapelle, Alexandre lui sourit, et Georges aurait donné même les billets pour ce sourire. Ils se retrouvèrent côte à côte à la sainte table. L’enfant embaumait la lavande. Il avait murmuré à Georges : « Ce soir, six heures. »
Quelle différence, de nouveau, entre un dimanche et un autre ! Il pleuvait aujourd’hui, mais Georges trouvait ce dimanche plus beau que le dernier, où avait brillé le soleil.
Sa mauvaise place en composition de sciences naturelles n’avait pu altérer sa joie. La seule place qui lui importât, c’était celle qu’il allait retrouver dans la serre.
« Je t’ai détesté tout à coup, dit Alexandre, lorsque tu m’as annoncé à la fois que tu n’avais pas gardé notre secret et que tu avais un ami. Ensuite, j’ai compris que cela n’était rien, qu’il y avait amis et amis, mais je voulais attendre pour voir ce que tu ferais, et de mon côté je ne savais que faire. Ne l’as-tu pas deviné à ma cravate rouge, l’autre dimanche ? Le matin, j’avais fait exprès de ne pas la mettre, mais cela me sembla mesquin et méchant, et je réparai. Pourtant, je ne pouvais pas rencontrer tes regards. J’avais honte de notre fâcherie. Mais je te contemplais en moi-même, et je t’aimais comme avant et même plus. »
Georges avait mis son bras autour du cou de l’enfant. Cette fois, c’était fait : il n’avait plus craint de l’embrasser, mais Alexandre avait rougi et ne lui avait pas rendu son baiser.
« Tu avais oublié, et tant mieux d’ailleurs ! dit Georges, que le dimanche, à cette heure-ci, je n’étais pas en étude. Il m’a fallu demander la permission de sortir en pleine académie. Sans doute le supérieur m’a-t-il jugé bien malade. Quand je suis parti, on discutait sur le Grand Dauphin, Je préfère mon petit dauphin. »
Puis il ajouta, en souriant :
« Tu n’es plus jaloux de Lucien Rouvère ?
— Je ne suis jaloux que de toi.
— À propos, quel jour es-tu né ? J’ai eu la chance de remarquer ta fête à temps, mais je voudrais encore moins laisser passer ton anniversaire.
— Je suis né le 11 septembre.
— Et moi le 16 juillet. Si nous ne sommes pas du même mois, nous sommes de la même saison, de l’été qui alanguit et qui brûle.
— Encore tes brûlures !
— Nous sommes aussi du printemps, puisque la Saint-Alexandre l’inaugure presque, et que la Saint-Georges est le 23 avril. »
Ils se dirigèrent vers la porte. Georges se retourna vers l’intérieur de la serre, comme s’il hésitait à s’arracher de ces lieux.
« Que les orangers sentent bon ! fit-il. C’est pour toi, pour ton printemps. »
L’enfant lui donna un baiser, aussi rapide que si c’était en cachette, et dit avec un sourire :
« Voilà mon printemps. »
Georges était revenu à son fauteuil. Le supérieur déclamait l’oraison funèbre, qui tirait à sa fin : « Ah ! modération de Cornet, tu dois bien confondre cette jeunesse aveuglée !… » Georges observait les académiciens. Celui-ci retirait ses lunettes à chaque instant, afin d’en essuyer les verres ; celui-là était drôle avec ses oreilles en forme d’entonnoir, qui entonnaient tout ce Bossuet ; l’un des philosophes faisait tourner infatigablement la chevalière qu’il portait à son doigt : il avait bien raison d’en être fier ; seul, un philosophe pouvait se permettre ici d’avoir une bague.
En arrivant à la séance de la congrégation, Georges regarda Alexandre. L’enfant, sérieux à son banc, avait eu un sourire imperceptible. Le père Lauzon parla de saint Joseph. C’était demain la Saint-Joseph.
Au dîner, Georges trouva, dans son tiroir, un billet qu’Alexandre avait dû y déposer au retour de la serre, lui ménageant cette surprise. Il le déplia et aperçut, retenue à un bout de papier gommé, une mèche de cheveux blonds. Au-dessous, étaient écrits ces mots :
Pour Georges, en souvenir de ma première fête et de notre grande réconciliation — cette boucle de mes cheveux (parfumés).
Plus tard, lorsqu’il fut allongé dans son lit, Georges prit ce billet, qu’il avait mis sous son traversin. Il le respira comme il avait respiré les orangers : une douce odeur en sortait.
Après s’être délecté du message, il s’interrogea sur le sens du principal événement de cette journée. La vérité qu’il avait entrevue, mais éludée, lui apparaissait maintenant éclatante : Alexandre et lui étaient au carrefour de la fable, entre le Vice et la Vertu. Ils avaient à choisir, et Georges resta un moment indécis devant ce choix. Il songeait à une phrase étrange de la mortelle oraison funèbre, enfin enterrée, où il était question des « prétextes honnêtes d’engagements déshonnêtes », auxquels le grand-maître du collège de Navarre n’épargnait « ni le fer ni le feu pour éviter les périls des occasions prochaines ». Georges était devant ces périls-là.
Sa responsabilité l’inquiétait. C’était lui qui, patiemment, sans scrupules, avait noué cette intrigue, et détourné Alexandre de la règle du collège. Il devait, au moins, respecter sa dignité de jeune garçon. Si André en avait agi autrement avec Lucien, il avait eu l’excuse d’avoir affaire à un égal, puisqu’ils appartenaient à la même division.
Georges avait circonvenu l’un de ceux que, sans doute pour de bonnes raisons, on tenait séparés de leurs aînés. La réunion organisée à la sainte table avait une intention mystique : il l’avait rendue sacrilège. Pendant plus d’un trimestre, Alexandre avait vécu tranquillement parmi ses camarades, assistant aux offices, entendant les sermons, occupé de ses devoirs. Il avait porté l’agneau de la consécration, servi la messe un mois entier. L’an dernier, à pareille date, il faisait des prières à saint Joseph, et aujourd’hui, il avait eu un rendez-vous dans une serre. C’est en rougissant qu’il avait reçu un baiser, mais à la fin il avait osé le rendre et n’avait pas rougi. Sa pudeur avait témoigné son innocence, et, en même temps, sa facilité montrait combien il était sensible à l’exemple.
Oui, Georges était bien la cause de ce trouble naissant, mais aux yeux de qui était-il coupable ? Alexandre et lui avaient le droit d’être leurs propres juges. Puisqu’ils étaient heureux, à quoi bon des remords superflus ? C’est l’enfant qui avait inspiré une telle amitié, et il avait prouvé, par ses actes, qu’elle était faite pour lui. Eh bien, c’est lui qui déciderait si elle conserverait la forme idéale ou en prendrait une autre. Georges s’en remettait à lui d’achever comme il voudrait l’œuvre commencée.
Néanmoins, afin de se préserver lui-même des entraînements, il jugea préférable d’espacer davantage leurs rencontres. Prétextant son discours académique, il contremanda le rendez-vous fixé à mardi et le renvoya à vendredi : Le vendredi est notre jour, écrivit-il.
Maurice était très content de lui. Il racontait, au milieu d’un petit groupe, qu’il avait reçu une lettre de sa bonne amie, par les soins d’un domestique du collège. Il indiquait la rémunération de ce service, pour les camarades que cela pouvait intéresser. Il disait, en riant, qu’une entremise de cet ordre était tout indiquée dans son cas, puisque sa bonne amie était la femme de chambre de sa mère, et il parlait librement des plaisirs que cette jeune personne lui procurait. Richepin était dépassé.
Maurice ajoutait que les choses n’étaient pas si aisées, parce qu’il partageait sa chambre avec son frère : il profitait des moments où il y était seul ; du reste, le danger ne rendait la chose que plus amusante.
Georges avait le cœur serré en entendant ces histoires, pires que celles de Lucien, des histoires qui n’étaient pas de leur âge, de leur condition d’écoliers, des histoires où, par une sorte de profanation, le nom de l’enfant était mêlé. Combien peu Maurice ressemblait à Alexandre ! Ses yeux ternes, ses joues sanguines, ses cheveux plantés bas, parlaient de passion terre à terre, autant que ses discours. Son impureté d’homme en herbe corrigeait auprès de Georges l’influence de Lucien, l’exemple des « mauvais camarades ». Elle lui faisait apprécier ce qu’était la pureté. Elle lui rendait plus chère la pureté d’Alexandre.
L’enfant était arrivé, tout courant. Georges avait fermé derrière lui la porte de la serre.
« Il n’est pas facile de m’arracher au père Lauzon, dit Alexandre. J’avais oublié de t’avertir que je me confessais dans sa chambre le vendredi, et non à la chapelle avec les autres le samedi. Il vient d’ordinaire me prendre vers six heures. Alors, à cause de ton rendez-vous, j’ai dû m’ingénier pour aller chez lui un peu plus tôt. Tu es tombé en pleine confession, comme, dimanche dernier, j’étais tombé en pleine académie. Or, après la confession, il y a la conversation. Mais quand j’ai vu à la montre, sur la table, qu’il était déjà six heures, j’ai dit que j’étais pressé, ayant à finir un long devoir, et me voici.
— Il ne me manquait que de succéder à la confession ! Nous aurons mis tous les sacrements en commun. Nous imitons les personnages de ce grand siècle dont on nous rebat les oreilles, qui menaient de front vie religieuse et vie sentimentale. Notre aumônier nous absout à un jour d’intervalle, sans remarquer que nous lui parlons l’un de l’autre — à mots couverts — et que nous lui faisons respirer le même parfum.
— Tu sais, le père n’est peut-être pas si bête que tu te l’imagines.
— Que veux-tu dire ? »
L’enfant se pencha sur une fleur d’oranger, puis sur une autre. Il s’enivrait voluptueusement de cette odeur, mais semblait aussi vouloir retarder le moment de répondre. Il s’était barbouillé de pollen. Dès que Georges l’eut essuyé, il escalada les gradins, comme le premier jour. Voyant que son ami se préparait à le suivre :
« Non, fit-il, reste en bas. J’aime mieux que tu ne sois pas à côté de moi pour ce que j’ai à te raconter. »
Georges s’appuya sur un caisse d’oranger.
« J’écoute, dit-il en mâchonnant une feuille.
— Le père vient de me déclarer qu’il me trouvait légèrement changé, qu’il s’inquiétait à mon sujet, qu’il sentait chez moi — pas notre lavande, je n’en mets pas quand je vais le voir — mais quelque chose de suspect. Il m’a pris sur ses genoux et m’a parlé à l’oreille. Il m’a demandé si je n’étais pas tracassé, si je ne faisais pas de rêves la nuit, si au moins je ne lui cachais rien. Je l’ai regardé si droit dans les yeux qu’il n’a pas insisté (je l’avais déjà fait aux mots : « quelque chose de suspect »). Il s’est borné à me donner deux recommandations : la première, de rester tel que je suis — j’avais envie de le remercier de ta part — la seconde, c’est de lire chaque jour, dans le missel, 1’ « oraison pour repousser les mauvaises pensées ». Il m’a dit que si, grâce à Dieu, je n’en avais pas encore eu, ça m’empêcherait d’en avoir. »
Georges connaissait bien cette oraison. Il l’avait lue, jadis, pendant la retraite, en vue de chasser les mauvaises pensées que Lucien lui inspirait. Et maintenant un prêtre recommandait à Alexandre la même prière, comme s’il avait deviné le péril qui menaçait cet enfant — l’oraison contre les mauvaises pensées était devenue l’oraison contre Georges. Les deux garçons restèrent un moment recueillis.
Ce soir, le crépuscule était sombre. Du haut des degrés, Alexandre, devenu invisible, prononça lentement ces mots :
« Georges, sais-tu les choses qu’il ne faut pas savoir ?
— Oui, je les sais.
— Est-ce qu’elles t’intéressent ? »
Il avait dit cela d’un ton grave. Cette gravité était-elle le signe d’une acceptation, comme celle de son regard, le jour où il était venu dans la cour des grands ? Que désiraient ou que craignaient ses douze ans ? Peut-être qu’il allait faire à Georges des aveux auxquels il s’était refusé avec le père. Les silhouettes d’André et de Lucien, jadis familiers de ces lieux, semblaient se dessiner dans la pénombre. L’irréparable était-il destiné à s’accomplir ? Georges se rappelait ses résolutions et ses dégoûts. Du même ton grave, il répondit : « Non, ces choses-là ne m’intéressent pas. » Alexandre descendit légèrement les marches. Une sorte de lumière éclairait son visage, qu’il approcha de celui de Georges.
« Que je suis content ! dit-il. Tu m’as rassuré. J’avais beau t’aimer, je me demandais ce que tu voulais de moi. Je redoutais quelque chose de mal. »
Avec tous les académiciens, Georges était au premier rang, dans la salle des fêtes, avant les professeurs eux-mêmes, non loin du cardinal, qui était venu présider cette séance solennelle. Assis dans son fauteuil vert, tenant la tête aussi droite que possible, de manière à être vu d’Alexandre, il songeait au billet qu’il lui avait passé à la communion :
Tout à l’heure, mes paroles ennuyeuses se changeront en caresses pour toi.
Ses parents assistaient à la cérémonie. Il avait eu l’honneur d’être présenté par eux à Son Éminence, qu’ils connaissaient.
M. le Supérieur ouvrit le feu. Il n’était pas monté sur l’estrade, peut-être pour ne pas dominer de trop haut le cardinal tout rabougri et recroquevillé dans sa pourpre. Il s’était tourné vers lui, à quelques pas, très simplement.
Il parla, en longues périodes, des « princes de l’Église qui sont également des princes de l’esprit », ce qui rappelait à Georges les propos du père Lauzon relatifs à la reine du ciel. Et il poursuivit :
« Que vos images de Saint-Claude, mes enfants, ne soient pas uniquement ce cadre admirable de vertes montagnes, la courbe gracieuse de cette vallée, la colline ensoleillée où s’élève notre demeure, ces travaux féconds dans la paix de notre solitude, ces fêtes religieuses où s’épanche votre piété, ni même ces maîtres dévoués qui vous prodiguent leurs lumières et leurs soins. Par-dessus ces diverses images, il faut que vous gardiez toujours, dans le fond de votre mémoire, comme dans une reliquaire, celle de l’auguste prélat qui vint sourire à vos jeunes années. »
Et monseigneur hochait la tête pour approuver, comme s’il eût été un académicien de Saint-Claude répondant au : « N’est-ce pas, messieurs ? »
En terminant, le supérieur expliqua le sens de la fête d’aujourd’hui : l’Église nous permet ces joies innocentes, en ce dimanche de « Lætare », où elle-même remplace, dans sa liturgie, la couleur violette du carême par la couleur rose. Georges n’était pas le seul à s’intéresser aux couleurs. Il eût été curieux de savoir ce que le supérieur aurait dit, non pas de la robe rouge du cardinal, mais de la cravate rouge de deux élèves, dont l’un était de son académie.
Un rhétoricien commenta, mi-sérieux, mi-badin, la Méditation sur le silence, de l’évêque de Meaux. Georges n’ignorait pas que le supérieur avait refait le discours de cet élève, comme ceux de tous les autres. Pour le sien propre, il n’en avait, certes, pas été étonné : l’Hôtel de Rambouillet l’avait laissé froid. La carte du Tendre lui avait bien inspiré quelques allusions qu’il jugeait spirituelles, mais le supérieur, en corrigeant son travail, les avait supprimées. Au reste, presque rien ne subsistait du texte primitif, et Georges n’avait eu que la peine de recopier le nouveau. Sous des noms différents, le supérieur était l’orateur universel de la journée. Qui, d’ailleurs, aurait discouru plus éloquemment du grand siècle ? Non moins que l’évêque de Meaux ne discourait du silence, disant que Jésus n’avait parlé qu’une fois dans son enfance quand il instruisit les docteurs.
Maintenant, le tour de M. l’académicien de troisième était arrivé : Georges s’installa sur l’estrade derrière la table. Ce n’était ni pour monseigneur ni pour ses parents qu’il prenait une noble attitude et soignait sa diction.
Le lendemain matin, à la chapelle, les grands arrivèrent les premiers. Lorsque entrèrent les petits, Alexandre se détacha de ses camarades, et alla se mettre à genoux, tout seul, au milieu du chœur.
Une telle punition était si extraordinaire que, depuis le commencement de l’année, on ne l’avait infligée que deux ou trois fois.
Georges contemplait ce spectacle. Il affecta d’abord d’en rire, comme d’une plaisanterie que l’enfant lui faisait. Il admirait sa grâce, son calme, sa fierté. Il était fier lui-même de leur amitié. Il lui semblait qu’Alexandre n’avait été mis là qu’afin d’être mieux vu de tous, mieux encore que dans les occasions où il s’était trouvé à cette place en qualité de servant. Mais, après avoir accordé quelques minutes à cette fiction, il fallait revenir à la réalité : Alexandre était puni, livré à la réprobation générale, et le lendemain du jour où Georges avait péroré si brillamment.
Ce dernier espérait que l’enfant, sur qui il avait reporté les honneurs de la veille, les avait partagés, et que le souvenir l’en réconfortait un peu. Néanmoins, il se les reprochait et aurait voulu être humilié à ses côtés. Se disant que le long contact du marbre devait lui être pénible, il voulut faire en sa faveur un geste symbolique, même dérisoire, et retira le petit tapis qu’il avait sous les genoux.
Qu’est-ce donc que l’enfant pouvait avoir fait ? Là-haut, dans la tribune, le père Lauzon, se retournant pour les bénédictions de la messe, voyait en bas son ancien acolyte en très fâcheuse posture. Ne devait-il pas se redire qu’Alexandre avait bien changé ? Tout à coup, une idée traversa l’esprit de Georges : que leur amitié fût la cause de cette sanction. Mais non, ce n’était pas possible, on les aurait déjà confrontés et ils seraient punis ensemble.
À la communion, quand Georges vint s’agenouiller, l’enfant se leva tranquillement et, les mains jointes, se mit auprès de lui, comme à sa place ordinaire. Il lui murmura : « Ce soir, six heures. » C’était la même formule que le jour de leur réconciliation, mais à présent elle avait eu pour Georges une autre résonance : à ne plus en douter, la punition d’Alexandre avait trait à leurs affaires. Sinon, celui-ci aurait-il avancé leur prochain rendez-vous, fixé à vendredi ainsi que le précédent ? Le billet d’hier avait dû être intercepté. L’heure de la vengeance d’André était venue.
Aux diverses études, quand la porte s’ouvrait, Georges, troublé, s’attendait à voir paraître le préfet qui allait l’appeler. Il était bien sûr qu’Alexandre n’avait rien avoué, mais le billet était signé du prénom de son auteur. On procédait sans doute à une enquête sur tous les Georges de la maison. Ce n’était qu’une question de temps. Pourvu, au moins, que la vérité ne fût pas découverte avant six heures ! Georges acceptait n’importe quoi, après le moment où il aurait pu rencontrer Alexandre. Entre les gâteries qu’il avait reçues la veille, il avait pris, pour la lui donner, une petite boîte de croquettes au chocolat.
Il salua comme une victoire la permission de sortir, mais se sentit de nouveau angoissé en faisant le guet au seuil de la serre. Il redoutait de ne pas voir arriver l’enfant, et fut plus heureux peut-être que la première fois, lorsqu’il reconnut le bruit de son pas dans le sentier.
Il avait deviné : c’était bien d’un billet qu’il s’agissait, mais d’un billet d’Alexandre. L’enfant lui conta l’histoire avec une fiévreuse volubilité :
Hier au soir, pendant l’étude, il avait voulu répondre au mot de Georges sur la lecture académique, et le préfet de sa division, qui était entré tout doucement, lui avait confisqué ce message, où, par bonheur, il n’y avait aucun nom. Dans l’interrogatoire qui suivit en tête-à-tête, l’enfant fut sommé de dénoncer son correspondant, et resta muet. Il avait été privé de dessert, mis à genoux une heure près de son lit, et averti que, s’il ne faisait pas des aveux complets avant la messe du lendemain, il irait en pénitence au milieu du chœur. Ce matin, le préfet se tenait à l’entrée de la chapelle et avait regardé Alexandre, qui était passé, indifférent, pour aller en pénitence comme on lui avait dit.
Durant la première étude, le préfet l’avait de nouveau appelé. Il avait, sur son bureau, le plan de son discours, qu’Alexandre déchiffrait à l’envers en l’écoutant. Une feuille de papier portait ces mots, écrits l’un au-dessous de l’autre : « Irréligion. Orgueil. Indiscipline. Tare. » Le préfet avait revu à sa manière la carte du Tendre, mais en avait été pour ses frais.
En désespoir de cause, on avait traduit Alexandre devant le tribunal suprême du supérieur. Ce dernier avait tout essayé : d’abord de l’attendrir, en lui rappelant qu’il était enfant de Marie ; ensuite de le tromper, en lui disant que son camarade était découvert, mais que l’on voulait obtenir ses propres aveux ; enfin, de l’effrayer. Il lui avait déclaré, en effet, que, puisque c’était ainsi, il demanderait à ses parents de le garder après les prochaines vacances : jusque-là, en pénitence chaque matin.
« Je me fiche bien de sa pénitence, dit l’enfant, mais si l’on me chasse, naturellement que tu me suivras !
— Oui, dit Georges.
— Nous irons ensemble dans un autre collège. C’est juré ?
— Oui, c’est juré. »
Alexandre lui prit la main et la pressa sur son cœur. Il avait bien perdu son calme, plus même qu’au premier rendez-vous ; il en avait, aujourd’hui, dépensé ailleurs les trésors. Il était frémissant.
« Que ces hommes que nous payons, s’écria-t-il, veuillent nous empêcher de faire ce qui nous plaît, quand nous ne leur faisons aucun mal ! Parce qu’ils appellent nos plaisirs une tare, ils se croient permis de nous en priver ! Mais je voudrais bien, par exemple, les voir me fouiller, cherchant les billets ! Je les grifferais, je les mordrais ! »
Comme pour changer les idées de l’enfant, Georges tira de sa poche la boîte de chocolats et la lui offrit : on goûta aux croquettes.
« Tu ne m’as rien dit du père Lauzon, demanda-t-il.
— De lui, je ne me soucie guère. Il n’a pas manqué à la fête, évidemment ! J’ai été avec lui en discussion serrée : cela compensait mon silence avec les autres. Mais j’avais une bonne raison : c’est dans la matinée qu’il m’a fait appeler ; alors, ne sachant si l’on me laisserait sortir à l’étude du soir, je lui ai dit que je désirais le revoir à ce moment-là, et je viens de prolonger la conversation jusqu’à six heures, comme l’autre jour après ma confession. Du reste, j’ai réussi à terminer mes devoirs, mais ils auront été un peu bâclés. Quant à mes leçons, afin de montrer que je n’avais pas perdu la tête, je les ai apprises encore mieux qu’à l’ordinaire, et j’ai bien fait, parce que j’ai été interrogé à chaque classe : je suis sur la sellette.
« Pour en revenir au père Lauzon, il m’a reproché de lui avoir fait « des confessions incomplètes », puisque j’avais « une intrigue coupable qu’il ne connaissait pas » — tout ça, ses expressions. Il semblait presque jaloux. Je lui ai dit qu’en mon âme et conscience, je ne m’estimais coupable de rien, puisque cette « intrigue » n’avait rien de « coupable », et que, par conséquent, je n’avais jamais vu la nécessité d’en parler. Il m’a répondu par une belle phrase : qu’à défaut de péché plus grave, j’avais commis celui de désobéissance, puisque je transgressais le règlement, et que j’étais en révolte ouverte contre mes maîtres, mes parents, Dieu, et vitam aeternam, Amen. Il prétend que je suis un grand pécheur, une pierre de scandale. Il a été jusqu’à vouloir m’interdire la communion, mais je l’ai arrêté en le menaçant d’écrire au cardinal et même au pape.
— Je vais réfléchir à ce que nous devons faire, dit Georges, et je t’en aviserai par un billet au réfectoire. En tout cas, aie confiance en moi, quoi que je décide, et abonde dans mon sens. Peut-être n’aurons-nous pas de quelque temps la possibilité de nous revoir, mais souviens-toi que j’aurai prononcé, aujourd’hui, en ta présence, le serment des jeunes Athéniens : « Je n’abandonnerai pas mon compagnon dans la bataille. »
L’enfant appuya sa tête à l’épaule de Georges et prenant un ton câlin qui ne lui était pas familier :
« Tu ne m’as pas demandé ce qu’il y avait dans mon billet, et j’allais oublier de te le dire : « Si tes paroles ont été des caresses, mes regards ont été des baisers… »
Il sourit, comme d’une malice, et s’échappa.
Quand Georges eut franchi la porte de l’étude, il fut interpellé par le surveillant, qui lui désigna le coin près de la chaire. Il crut un instant que cette punition était en rapport avec celle d’Alexandre, mais fut tout de suite rassuré : le doigt levé vers l’horloge, le surveillant lui montrait qu’il semblait avoir oublié l’heure. Il était sorti sous prétexte de mal de tête, mais ce prétexte avait des limites. L’enfant, de son côté, serait-il de nouveau puni ?
Debout, les bras croisés, et regardant la muraille, Georges entendait derrière lui les bruits de l’étude : des pupitres ou des livres se fermaient, une règle tombait, des porte-plume tapaient dans les encriers ou crissaient sur le papier. La plupart des camarades étaient enchantés, certainement, de le voir planté là, lui qui n’avait jamais été puni. Mais lequel d’entre eux l’avait été pour une histoire où il fût même question d’écrire au pape ?
Georges pensait à Lucien, seul à compatir avec lui, comme à connaître son secret. L’imaginative de ce cher garçon avait dû s’exercer pendant une si longue absence. Heureusement qu’il n’avait eu qu’à se donner la peine de copier la version latine. Puisqu’il ne croyait jamais à des événements fâcheux — suivant son ordinaire, il s’était employé tout le jour à rasséréner Georges — il avait supposé sans doute que les hôtes de la serre se disaient plus de choses que celui-ci ne consentirait à l’avouer.
Georges admirait le jeu de la destinée. Il se trouvait avec Alexandre dans la situation où, par sa faute, Lucien s’était trouvé avec André : l’un des deux amis — mais, présentement, le plus jeune — était compromis à cause de l’autre, et cet autre était épargné grâce à l’absence de son nom sur le papier accusateur. En tout cas, la petite sanction que subissait Georges annonçait que l’inégalité du sort se corrigeait déjà à ses dépens. Et ce n’était peut-être qu’un début. Mais aussi, pour le sien, quelle preuve charmante l’enfant avait donnée de sa force ! Il avait bravé tour à tour le préfet, le supérieur, le père Lauzon ; il avait méprisé les vexations, les menaces, fait ses devoirs, appris ses leçons, et il était venu exactement au rendez-vous.
Il ne fallait pas être au-dessous de tels exemples. Georges arrêtait une décision qui en serait digne : il se dénoncerait, afin de justifier Alexandre. Il se justifierait lui-même en réduisant l’aventure à une gaminerie. Tant pis si cela ne correspondait pas aux intentions de l’enfant, à son goût de la lutte ! Georges était l’aîné et serait le plus raisonnable. Il n’était pas ému par la perspective d’avoir à quitter Saint-Claude, comme il l’avait promis, si les choses se gâtaient, mais il lui paraissait naturel de tâcher d’y rester en les arrangeant.
Il irait trouver le père Lauzon, obtiendrait son pardon et son appui. Celui-là ne se méfiait pas de Georges. Il eût été plus réticent avec Marc, qui n’était pas un congréganiste. D’autre part, il ne demandait qu’à continuer de croire à la vertu d’Alexandre. Lui était-il possible d’admettre réellement que le cœur de son petit favori lui eût été fermé ? Et d’ailleurs, puisque ce cœur était resté pur, on aurait pour défense la force de persuasion de sa pureté. Mais il ne suffisait pas de gagner la cause, il était indispensable de la gagner vite.
Georges ne pouvait souffrir l’idée qu’Alexandre fût encore à genoux demain matin, affiché comme ne l’avait été aucun élève du collège. Il supplierait le père d’intervenir dès ce soir auprès du supérieur en vue de faire rapporter cette mesure. Quelle surprise aurait Alexandre ! Il serait bien obligé d’accueillir l’indiscrétion de son ami à l’égard des maîtres plus favorablement qu’il ne l’avait accueillie à l’égard de Lucien.
Hélas ! la montre, d’accord avec l’horloge, indiquait sept heures moins le quart. Bientôt, la lecture spirituelle, puis le dîner, puis le coucher, et c’en était fait pour aujourd’hui.
Au coup de cloche, Georges put regagner son banc. En voyant entrer le supérieur, une autre idée lui vint : aller trouver directement ce personnage. Ne vaut-il pas mieux s’adresser à Dieu qu’à ses saints ? C’était la seule chance de régler immédiatement la question. Mais quand serait-ce faisable ? Après la lecture spirituelle, durant les quelques minutes qui précédaient le repas ? Ou plus tard, au sortir de table ? Dans les deux cas, le supérieur renverrait le solliciteur à demain — demain, après la méditation et la messe. C’est donc la ruse, et presque la force, qu’il y avait lieu d’employer pour se faire recevoir cette nuit.
Georges observait le visage du supérieur. Cet homme qui avait été jusqu’à présent celui qui faisait la lecture spirituelle chaque soir, celui qui dirigeait la méditation du matin et qui célébrait ensuite la messe publique, celui qui disait le bénédicité et les grâces aux repas, les notes du mois en étude, les places de composition le dimanche, qui déclamait Bossuet, qui écrivait des sonnets et les discours des académiciens, qui avait parlé à Georges du Collegium Tarsicii et lui avait prêté des livres sur l’antiquité, cet homme saurait tout à l’heure pour qui Alexandre Motier changeait ses regards en baisers, pour qui Georges de Sarre changeait ses paroles en caresses — le discours du supérieur sur l’Hôtel de Rambouillet était devenu une caresse, la Muse en grands atours une muse de Richepin. Au fond, Georges éprouvait une certaine vanité : il se révélerait à ses maîtres comme l’ami secret du plus charmant de leurs élèves.
Il avait d’abord été fier de son mouvement de courage. Mais en écoutant parler le supérieur, il ne pouvait s’empêcher de se dire qu’on trompait bien aisément cet homme-là. De la méditation à la lecture spirituelle, du matin au soir et du soir au matin, lui et ses pareils n’existaient que pour être trompés. Mais sans doute l’était-il plus que les autres, son apostolat étant le plus infatigable. Les pensées et les sentiments de tous ces garçons qu’il croyait connaître lui échappaient autant que leur conduite. En ce moment, on semblait attentif à sa lecture du Petit Carême de Bossuet, qui est préférable à celui de Massillon, avait-il dit. Maurice devait songer à sa jeune bonne, quelque Marc de Blajan à quelque jolie cousine ; ceux que le même Blajan appelait les mauvais camarades devaient songer à leurs complices ; Georges savait à qui pensait Lucien, et Lucien savait à qui pensait Georges. Les paroles du Petit Carême retentissaient dans le désert. Au supérieur également, Georges débiterait des paroles creuses, mais il les lui ferait prendre pour des vérités.
Lucien, mis au fait pendant le dîner — il y eut heureusement Deo gratias — approuva son projet.
« Si j’avais pu sauver André, dit-il, je n’aurais hésité devant rien. »
Il aida Georges à arranger l’histoire que ce dernier raconterait. Ils étaient à la fois sérieux et joyeux. Les intérêts en cause les faisaient réfléchir, mais Lucien déclarait envier à Georges l’honneur de cette visite impromptue. Il eût été curieux de voir le supérieur en négligé. Celui-ci serait-il en robe de chambre, montrant ses scapulaires, comme Lucien lui-même autrefois, et ces sachets de camphre que, dit-on, les prêtres accrochent sur eux, afin de garder leur vertu ? C’étaient là d’autres sachets que celui de la poésie du Bien-Aimé.
Au dortoir, la veillée des deux amis fut une veillée d’armes. Dès que l’abbé fut couché :
« Bonne chance, mon vieux, dit Lucien. Je ne m’endormirai pas jusqu’à ton retour. »
Georges se leva doucement et se rhabilla. Se rappelant la phrase d’Alexandre sur les billets à défendre, il jugea prudent de mettre les siens à abri : il les retira de son portefeuille et les enferma à clef dans sa boîte de toilette. Il prit sa lampe électrique, serra la main de Lucien et sortit à pas de loup.
Une fois dans le couloir, les risques de sa démarche lui apparurent soudain. C’était comme le jour où il avait voulu dénoncer André ; se dénoncer était plus grave. Il s’étonnait que Lucien ne l’en eût pas détourné. Il était près de conclure que l’ami de son ancienne victime était poussé par une sorte d’instinct de revanche. Le moins qu’il y eût à craindre, n’était-ce pas d’indisposer par ce dérangement intempestif ? Mais à neuf heures et demie, le supérieur n’était certainement pas couché. Il revisait peut-être ses sonnets champêtres ou préparait le commentaire du Petit Carême de demain.
D’ailleurs, si aucune lumière ne s’apercevait sous la porte du bureau, ou s’il y avait quelque professeur en train de bavarder, Georges rentrerait au dortoir avec la même discrétion qu’il en était sorti.
Dans l’antichambre, il put s’assurer que le supérieur veillait et était seul. La statue de saint Tarsicius, que sa lampe avait éclairée, le fit souvenir de sa visite d’octobre. Ses intentions d’aujourd’hui étaient plus honorables et rachetaient un peu celles d’alors. Au reste, venant à son tour en présence du même juge, il se devait bien d’être aussi fort qu’André. Il n’avait plus d’appréhension. Il ressentait d’avance la joie de feindre des aveux pour rétablir le mensonge. Il allait préserver l’essentiel en sacrifiant le superflu.
Le supérieur, qui était dans sa tenue de jour, lisait, assis sous un lampadaire. Certes, il sembla fort étonné de voir à qui il avait dit d’entrer.
« Excusez-moi, monsieur le supérieur, fit Georges. J’ai quitté le dortoir sans permission, mais je ne pouvais dormir en pensant qu’à cause de moi, un de mes camarades était puni. »
Le supérieur lui indiqua un siège, et, ayant drapé sa douillette d’un air majestueux, il ferma le livre sur ses genoux. Georges ne s’était pas enfoncé dans le fauteuil aussi hardiment que l’académicien du dimanche. Comme le soir où il songeait à André, il gardait les yeux baissés. Mais aujourd’hui, sa modestie n’était qu’apparente et destinée à colorer ses discours.
Il raconta les choses, telles qu’il les avait mises au point pendant le dîner : Alexandre et lui s’étaient connus par Maurice, un dimanche, dans la cour des grands. Ils avaient bavardé et Alexandre avait manifesté l’espoir de devenir académicien. Georges, pour rire, s’était plu à lui promettre sa protection. Parlant de la séance publique prochaine, celle de mardi dernier, il avait dit qu’il lirait son discours de sa voix la plus caressante, et cela avait donné lieu à quelques plaisanteries. Depuis lors, ils ne s’étaient retrouvés qu’une fois par hasard, devant la porte du père Lauzon, leur confesseur à tous deux.
Georges était surpris du calme avec lequel il avait parlé. Sa confiance en était grandie. Il était prêt à soutenir le regard du supérieur, et aurait bravé les supplices de l’ancienne question. Il n’était pas éloigné de se croire sincère.
Le supérieur tenait les yeux fixés sur la couverture de son livre — un tome des Impressions de Théâtre, de Jules Lemaître. Allait-il citer Nicolas Cornet ? Lentement, sans lever la tête, il demanda à Georges :
« Comment le jeune Motier vous a-t-il instruit de l’incident ?
— Par l’entremise de Lucien Rouvère, qui le connaît au titre de la Sainte Enfance, et l’a, ce soir même, rencontré providentiellement dans le couloir. Rouvère m’a fait la commission à table, à la faveur du Deo gratias.
— Que vous a-t-il dit exactement ?
— Qu’Alexandre Motier avait eu l’idée de me faire une sorte de farce par écrit, à propos de mon expression de « voix caressante », mais qu’il s’était fait prendre, et qu’on le tracassait, parce que, naturellement, il ne voulait pas me mettre en cause.
— Il a consenti, du moins, à faire un aveu, dit le supérieur en regardant Georges : c’est qu’il avait déjà expédié à son distingué correspondant d’autres billets. Je ne souhaite les lire qu’en tant qu’il s’agit de vous, car, pour le peu que j’en connais, le style est déplorable : le modèle en est pris dans des romans de quatre sous. Voyons donc, s’il vous plaît : veuillez me montrer votre portefeuille.
— Mais je n’ai jamais reçu aucun billet du petit Motier !
— Il aura donc menti. D’ailleurs, n’importe. J’aime à me rendre compte, à l’occasion, de ce que renferment les portefeuilles de mes élèves. »
Georges avait rougi, mais ce n’était pas de honte : il avait eu une bouffée de joie en pensant à la bienheureuse précaution de tantôt. Il était vengé de ce supérieur, qui venait de mentir en accusant Alexandre de mensonge, mais peut-être que ses mensonges à lui s’appelaient des « directions d’intentions ».
Sans doute le supérieur remarqua-t-il l’émoi de son visiteur :
« Ne vous offensez pas de ce que je vous demande, dit-il. Mon devoir est de vous prouver qu’un garçon de votre âge ne doit pas avoir de secrets. »
Georges tendit son portefeuille gonflé. Le père l’ouvrit avec soin, comme si une somme importante ou des documents accablants allaient s’en échapper.
La première poche qu’il regarda fut celle d’où les billets d’Alexandre avait été retirés, il y avait quelques instants. Mais Georges, pour ne pas la vider entièrement, y avait laissé la carte illustrée de l’Amour de Thespies. Le supérieur contempla un instant cette image.
« La statue est de Praxitèle, dit Georges, et elle se trouve aujourd’hui au Vatican. Il en était question dans la Mythologie que vous m’avez prêtée. »
Sans répondre, le supérieur remit dans le portefeuille l’Amour de Thespies.
Les autres poches livrèrent divers papiers — des papiers que Georges conservait, bien qu’aucun ne l’intéressât : une carte d’identité scolaire de l’année précédente, celle de membre actif de la « Ligue Maritime et Coloniale », la réclame illustrée d’une marque d’automobile, une fiche pharmaceutique de pesée, un prospectus de tourisme, et 1’ « oraison à l’ange gardien d’un enfant absent ».
« Cette prière permet de gagner quarante jours d’indulgence », dit-il.
Il y avait aussi une carte de visite de ses père et mère, avec les titres de marquis et marquise. Cela faisait bien. Le supérieur examina ensuite la vue d’un château.
« C’est notre domaine, dit Georges, qui ajouta en souriant : Je dois tout expliquer. »
Il n’était pas fâché de rappeler un peu qui il était. Le supérieur était noble, mais cela ne voulait pas dire que ses parents eussent possédé un château.
Enfin, la dernière poche contenait un billet — un billet de banque — et, comme la première, une carte postale : la photographie d’Anatole France, qui faisait pendant à l’Amour de Thespies.
« Vous n’ignorez pas que les ouvrages de cet auteur son à l’Index, dit le supérieur en rendant le portefeuille.
— Je n’ai lu de lui que Le livre de mon ami, où ce portrait était inséré.
— N’en lisez jamais rien d’autre. Et même, tenez ! Donnez-moi cette photographie et celle de la statue : elles ne sont guère à leur place dans le portefeuille d’un enfant de Marie. »
Georges les prit et les lui présenta. Le supérieur les considéra un moment, réunies dans sa main, telles les cartes d’un jeu. Mais, comme s’il voulait témoigner son respect à la fois pour la Grèce et pour le Vatican, il rendit à Georges, d’un geste large, la gravure antique. Puis, sèchement, il déchira en quatre le portrait d’Anatole France et en jeta les morceaux dans la corbeille à papier : un d’eux tomba sur le tapis, montrant la barbe de l’illustre académicien dont le directeur de l’académie de Saint-Claude venait de faire justice.
« Bon ! dit le supérieur. Je vois que vous m’avez dit vrai, et passe condamnation, mais j’espère que la leçon vous servira. Ne choisissez vos amis que parmi vos camarades de classe. C’est le meilleur moyen d’éviter des complications qui, lorsqu’elles ne sont pas des plus graves, sont au moins ridicules. Vous seriez confus si vous saviez en quels termes ce grimaud vous écrivait. Les jeunes imaginations prennent vite le mors aux dents. Il importe donc de les laisser tranquilles. Vous êtes déjà lié avec Lucien Rouvère : tenez-vous-en à lui. Il est sûr et plein de bon sens.
« Je vous félicite d’ailleurs du scrupule qui vous a conduit ici ; mais vous êtes venu sans permission, et, pour satisfaire la discipline, je dois vous imposer une sanction : ce sera d’être consigné dimanche prochain. »
Dans le couloir, Georges se sentait tout allègre. Le dernier sonnet du supérieur lui revint en mémoire :
J’aime les larges soirs, soirs immensément doux.
Il éclata de rire. Il se répéta le vers du fabuliste, que le supérieur avait cité à titre de référence poétique :
Jours devenus moments, moments filés de soie !
Au passage, il fit, avec sa lampe, des illuminations moqueuses sur les cadres des anciens élèves. Même si Alexandre était encore puni demain matin, et lui dimanche, ils n’étaient pas moins, l’un et l’autre, hors d’affaire. L’enfant, malgré l’entêtement qui avait gâté sa cause, ne pouvait plus être suspect. On s’expliquerait son attitude par la hauteur de son caractère, et non par la gravité de ses secrets. Sans doute, restait à savoir aux deux amis comment leurs futurs rendez-vous pourraient reprendre, mais après cette victoire, il était permis de tout espérer. L’image de Thespies, sauvée par miracle, attestait une fois de plus que l’amitié était sauvée.
Georges rentra doucement dans le dortoir. Il ne voulut pas réveiller Lucien, qui s’était endormi, comme l’apôtre sur le mont des Oliviers. Cher Lucien ! Il semblait avoir tenu à lui prouver néanmoins qu’il l’avait attendu : en effet, il était couché dans la position qu’il adoptait pour bavarder avec lui, c’est-à-dire sur le côté gauche, au lieu que, pour dormir, il se mettait d’ordinaire sur le côté droit, lui tournant le dos.
Alexandre devait être également plongé dans le sommeil, sans se douter que tant de choses venaient d’être accomplies. Dormait-il, lui, sur le côté, afin de laisser moins de prise aux rêves ? Ou sur le dos, comme Georges, afin de mieux les accueillir ?
Le lendemain, ce dernier bénissait la tribune qu’il avait longtemps maudite : Alexandre y servait la messe au père Lauzon. Le père avait certainement imaginé ce moyen de soustraire Alexandre à une nouvelle humiliation, la pénitence n’étant pas encore levée. Mais plût au ciel qu’en vue de le catéchiser, il ne le retînt pas après l’office ! Dans le cas où il serait déjà instruit de la déposition de Georges, et en parlerait à l’enfant, celui-ci risquait de se fourvoyer. Il importait que la version officielle fût connue de l’intéressé le plus tôt possible. Un billet, rédigé pendant l’étude qui suivait la messe, serait déposé par Lucien au réfectoire avant le petit déjeuner.
Georges commençait à écrire, lorsqu’on l’avertit que le père Lauzon le demandait. Il regretta de n’avoir pas eu le temps de terminer son message, mais sortit rapidement pour être de retour plus vite.
En arrivant devant la porte de la chambre, il entendit parler le père. Qui pouvait bien être là ? C’était Alexandre. Il venait d’arriver sans doute, car il se tenait debout, et sans doute aussi ne savait-il rien encore, car il parut stupéfait de voir Georges.
Le père les fit asseoir l’un en face de l’autre, des deux côtés de son bureau. L’enfant gardait un visage fermé, mais sembla se dérider à un petit clin d’œil que Georges lui adressa. Pourvu qu’il se souvînt des recommandations de la veille, qu’il ne contredît aucune réponse, qu’il saisît la nouvelle chance qui s’offrait !
« Je vous ai fait venir dès ce matin, leur dit le père, afin de vous parler des relations que vous avez nouées entre vous et à mon insu. »
Il prit un temps, et contempla L’adoration de l’Agneau. Puis, se tournant vers Georges :
« M. le supérieur m’a informé, avant la méditation, de l’aveu que vous lui aviez fait la nuit dernière. Je m’étonne que vous n’ayez pas songé à vous confier d’abord à moi.
— J’ai pensé, mon père, répondit Georges, qu’il s’agissait moins d’une affaire de conscience que d’une affaire de discipline ; et, comme elle concernait deux élèves n’appartenant pas à la même division, je ne l’ai pas soumise non plus à M. le préfet.
— Ce n’était peut-être pour vous qu’une affaire de discipline, mais cela devenait malheureusement une affaire de conscience pour votre camarade, dit le père en regardant Alexandre qui resta impassible.
« Vous, continua-t-il, vous ne faisiez que plaisanter, et lui vous a pris au sérieux. Vous aviez parlé de « voix caressante » et lui vous envoyait des baisers — vous entendez bien : des baisers ! »
Le père accompagna ces paroles d’un petit rire, qui rappela à Georges celui dont Blajan avait souligné les siennes sur les faits et gestes d’André. L’enfant rougit violemment, d’un air outragé. Georges dit aussitôt d’un ton ironique :
« Des baisers vraiment ? Pourquoi pas des croquettes au chocolat ? »
Alexandre, à son tour, éclata de rire — d’un rire bien différent de celui du père, d’un rire vainqueur, où Georges sentait une revanche secrète : l’évocation du rendez-vous d’hier avait été pour eux un autre baiser.
« La glace est enfin rompue, dit le père en souriant. Une facétie a obtenu plus de résultats que tous mes discours. Elle achève de me convaincre qu’il ne fut question entre vous que de facéties.
« Le rire des enfants est le langage de leur âme. Les êtres corrompus ne rient jamais. Vous êtes demeurés des enfants, Dieu merci ! Mais vous aurez mesuré, sans trop de frais, le grand inconvénient des relations irrégulières. Ce qui est clandestin est presque toujours fâcheux.
« Au fond, je n’avais jamais été très inquiet sur le compte de ce jeune luron, parce que je le connais bien. Mais sa petite tête avait fait un monde d’un rien, d’une fable une histoire. Si, dès le premier jour, il avait avoué le nom du destinataire, tout se serait apaisé incontinent. Et je ne sais, au contraire, comment cela aurait fini, si le destinataire en question n’était intervenu.
« Il ne restera à M. Alexandre qu’à faire ses très humbles excuses à M. le supérieur. »
De nouveau, Alexandre rougit : on voyait que c’était trop lui demander. Mais Georges lui fit signe d’acquiescer. Et l’enfant dut comprendre qu’on pouvait s’excuser en demeurant le plus fort, céder sans être vaincu.
« Quand vous voudrez », dit-il.
Le père parut satisfait.
« L’ange du collège redevient l’ange du collège. Par cette expression, je ne veux pas exciter votre vanité, mon enfant, mais votre zèle : c’est ainsi, en effet, que l’on surnommait saint Jean-François Régis lorsqu’il était collégien. »
Il se leva et baisa légèrement les cheveux de Georges et d’Alexandre.
« Dans sa première épître aux Thessaloniciens, dit-il, saint Paul termine par ces mots : « Saluez tous nos frères d’un saint baiser. » Il y a baisers et baisers : les baisers des romans, où il convient de les laisser, et les saints baisers — baiser d’un enfant à ses parents, baisers de paix, baisers de pardon.
« L’apôtre, dans la même lettre, donne également ce conseil : « Priez sans cesse. » Le révérend père prédicateur vous y avait exhortés, dès la première conférence d’octobre, et M. le supérieur l’a répété au cours de son allocution de bonne année. C’est la prière, assurément, qui vous a préservés tous les deux des dangers que vous avez courus sans le savoir. Je n’ignore pas que vous êtes fidèles à la pratique de la communion quotidienne, qui est la plus belle de toutes les prières.
— Je n’y ai manqué qu’une fois ce trimestre, dit Georges.
— C’est probablement, dit Alexandre, le jour où tu es resté au lit parce que tu étais malade. »
Alexandre paraissait enchanté d’avoir rendu à Georges l’allusion des croquettes, en rappelant à son tour, devant le père, quelque chose de leur amitié — du temps de cette brouille qui avait grandi leur amitié. Mais la phrase était imprudente : elle témoignait un intérêt trop tendre.
« Je vois, dit le père, qu’il était temps de mettre un peu d’ordre dans vos sentiments. La sympathie que vous aviez l’un pour l’autre n’aurait pas tardé à troubler même vos exercices religieux. Cessez donc, à partir d’aujourd’hui, ces rapports prématurés. L’an prochain, vous serez ensemble, vous serez de vrais condisciples. J’espère qu’alors, loin de tout romantisme, il vous sera permis de refaire votre amitié. »
À la chapelle, l’enfant n’était plus le vis-à-vis de Georges. Il était remplacé au premier banc, et Georges finit par le distinguer au dernier. Le réfectoire était désormais le seul lieu où il leur fût possible d’échanger un regard.
Georges s’abstint quelque temps de la moindre initiative. Il évita de demander à sortir durant les études, pour ne pas faire soupçonner de rendez-vous. Il fallait feindre d’être rentré dans l’ordre, avant de chercher à s’évader de nouveau. On était à douze jours des vacances pascales. Au retour, l’incident, d’ailleurs inconnu des élèves, aurait été oublié en haut lieu. Le sacrifice n’était pas grand de rester tranquille jusque-là.
Georges avait aussi une arrière-pensée, qui tantôt le faisait sourire et tantôt le réconfortait : il attendait un miracle. Tout n’avait-il pas été miraculeux entre Alexandre et lui, y compris la façon dont ils s’étaient tirés d’un mauvais cas ?
La semaine n’était pas écoulée, qu’il trouva cet état de choses insupportable. Puisque le miracle ne venait pas, il irait vers lui, comme Mahomet allait vers la montagne. Il lui parut absurde de s’imposer de telles entraves sur de simples présomptions. Il décida d’éprouver cette discipline qu’il supposait renforcée à son égard. Un matin, il sollicita la permission de s’absenter : elle lui fut accordée avec la bienveillance ordinaire, et il goûta le plaisir de se revoir en liberté.
Il entra dans la serre, que les orangers embaumaient toujours. Il respirait les fleurs qu’Alexandre avait respirées. Il s’assit sur les degrés où ils s’étaient assis côte à côte. Les images que ces lieux évoquaient lui firent mieux sentir les contraintes actuelles. Il décida de se mettre en campagne, selon son ancienne méthode.
Elle consistait principalement à visiter le père Lauzon, dans l’espoir d’une rencontre avec Alexandre. Les prétextes n’étaient plus des scrupules de conscience, mais des conseils de lectures pour les vacances. Georges discutait certaines interdictions du manuel de l’Index. Faute de retrouver Alexandre, il aurait été heureux de parler de lui, ne fût-ce qu’une fois. Il porta la conversation sur saint Jean-François Régis et demanda la biographie de « l’Ange du Collège ». Mais le père ne laissa pas dévier le sujet, et parla ensuite de saint Thomas, que l’on appelle, pour d’autres raisons, « l’Ange de l’École ».
Georges avait écrit un billet fort doux, qu’il comptait mettre dans le tiroir d’Alexandre, pendant une récréation. Il allait au piano plus souvent que de coutume. Il portait des feuilles de mûrier aux vers à soie du professeur d’histoire, ou un biscuit à sa souris. Ce n’était que dans le dessein d’entrer au réfectoire en passant, mais toujours quelqu’un s’y trouvait : on eût dit un fait exprès.
Ce dimanche des Rameaux, avant-veille des vacances, la procession se déroula à l’intérieur de la chapelle, en raison du mauvais temps. Georges, parmi les premiers des grands, suivait les derniers élèves de la division des petits, qui marchait en tête. Il n’avait été séparé d’Alexandre que par trois de ses camarades. Avec un peu d’habileté, il aurait pu être son voisin, et l’enfant regrettait manifestement qu’il n’y eût pas songé. Celui-ci, en effet, paraissait avoir, de son côté, un message à lui remettre. Georges avait cru distinguer l’habituel carré de papier dans le creux de sa main. Il se jugea plus sot que jamais et, se vengeant aux dépens de son rameau, n’y laissa qu’une feuille.
Furieux d’avoir manqué doublement une si belle occasion, il se promit de faire parvenir, à toute force, et aujourd’hui même, son billet. Mais une nouvelle tentative qu’il fit au réfectoire avant midi se montra également inutile. Sans doute qu’Alexandre n’avait pas été plus heureux dans ses propres entreprises, puisque Georges ne trouva rien de lui. Ils se comprenaient maintenant à merveille. Les regards qu’ils échangèrent étaient pleins, à la fois, d’espérance et de dépit.
Georges s’était juré de rétablir le premier la liaison épistolaire, mais il lui sembla qu’il serait plus audacieux si son billet était moins compromettant. Il le déchira et en rédigea un autre plus anodin, qu’il déchira aussi. Il aimait mieux ne rien écrire que d’en écrire trop peu. Il se contenta d’indiquer son adresse sur un bout de papier, en l’accompagnant de ces seuls mots : À toi.
Le soir, en revenant de l’académie, il réussit à s’acquitter de sa mission. Il fut désolé de n’avoir pas conservé le premier texte. Tant pis ! Il se rattraperait à Pâques, en fait de correspondance.
Le lendemain, au dîner, il y avait dans son tiroir le message d’Alexandre : le sort les récompensait enfin tour à tour. Ce message était une feuille arrachée au livre de cantiques, et dont le texte avait été découpé de manière à présenter un autre sens.
Au haut de la page, était imprimé ce titre général : « Temps de la Passion », et, au-dessous, celui du cantique : « Noble bannière de Jésus-Christ. » Ce n’était pas un doux hymne de tendresse, comme celui de la veille du départ au « Temps de Noël ». C’était bien l’hymne d’une passion, déjà riche en ardeur et en tourments. Georges, qui le lut sous ses draps à la lumière de sa lampe, en était troublé. Il voyait passer les couleurs de la tragédie sur ce qui avait eu jusqu’à présent celles de l’églogue. L’enfant ne le raillerait plus de ses mots.
Je t’aime, je t’adore…
Qu’à jamais sur mon cœur
Ma tendresse t’enlace !
Quand d’amères alarmes
Oppresseront mon sein,
Tu recevras mes larmes.
Et mes lèvres tremblantes,
Au jour de la douleur
S’attacheront brûlantes
À tes pieds…
Restez sur ma poitrine,
Présents du Bien-Aimé !
Caché dans mes blessures,
Je m’enivre d’amour…
Au dos de la feuille, deux lignes étaient tracées au crayon : Ne m’écris pas. Je t’écrirai.
Georges, revenu à sa place après la communion, regardait Alexandre approcher de la sainte table. Il s’emplissait les yeux de l’aimable vision ; il tenait à s’en emplir le cœur pour les vacances qui commençaient aujourd’hui. Malgré les rigueurs des deux semaines qui venaient de s’écouler, il était presque fâché de ces vacances.
À la gare, comme le père Lauzon partait de nouveau en compagnie de Maurice et d’Alexandre, Georges dut monter dans une autre voiture que la leur. Mais, moins timide qu’à Noël, il désira revoir l’enfant une dernière fois. Par les soufflets, de wagon en wagon, Lucien et lui allèrent en reconnaissance. Ils repérèrent le compartiment, dont la porte vitrée était close, et passèrent lentement, en feignant de bavarder.
Le père Lauzon lisait son bréviaire. Alexandre, en face, la tête appuyée contre la paroi, semblait dormir. Il était enveloppé de son manteau bleu, mais, entre les deux pans, ses genoux montraient leur lumière et cette lumière paraissait ruisseler : il avait roulé ses chaussettes jusqu’à ses chevilles, sa jambe était plus nue. Georges aurait souhaité ne pas être obligé de se retirer discrètement. Il aurait voulu être seul avec lui et s’asseoir à ses pieds pour y attacher, lui aussi, des lèvres brûlantes, et poser ensuite la tête sur ses genoux, comme à leur première rencontre dans la serre.
| 1re partie | 2e partie | 3e partie |
| 4e partie | 5e partie |
Sources
- Les amitiés particulières : roman / Roger Peyrefitte. – Éd. définitive. – Paris : Librairie Générale Française, 1973 (La Flèche : impr. Brodard et Taupin). – 448 p. : couv. ill. en coul. ; 17 cm. – (Le livre de poche ; 3726). (fr)Rééditions en 1975 et 1978. – ISBN 2-253-00446-4 (broché)Texte de la deuxième partie, p. 93-188.
- Les amitiés particulières : roman / Roger Peyrefitte ; avec, en frontispices, 2 lithographies originales de Valentine Hugo. – [Paris] : Jean Vigneau, 1946 (Paris : J. Dumoulin ; Desjobert, 4 décembre 1946). – 2 vol., [6]-184 p.-1 pl., [6]-184 p.-1 pl. : 2 lithographies, jaquettes ill. ; 28 × 19 cm. (fr)Tirage limité à 990 ex. numérotés sur vélin de Lana, dont 90 hors commerce.Un frontispice de Valentine Hugo, tiré du tome premier.
- Les amitiés particulières : roman / Roger Peyrefitte ; lithographies de Goor. – [Paris] : Flammarion, 1953 (J. Dumoulin ; Marcel Manequin, 10 mai 1953). – 2 vol., [8]-184 p.-12 pl., [8]-184 p.-12 pl. : 24 lithographies ; 29 × 20 cm. (fr)Tirage limité à 740 ex. numérotés (10 ex. numérotés de 1 à 10 avec une suite des lithographies tirées en bleu sur vergé crème des Papeteries de Rives et une suite des gravures refusées ; 20 ex. numérotés de 11 à 30 avec une suite des lithographies tirées en bleu sur vergé crème des Papeteries de Rives ; 700 ex. numérotés de 31 à 730 ; 10 ex. numérotés de I à X).5 lithographies de Gaston Goor, tirées du tome premier.